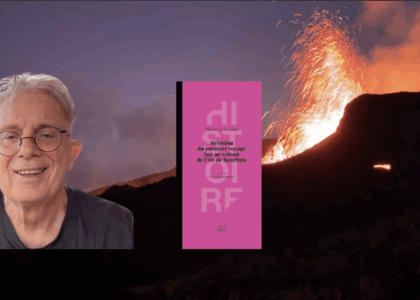Le documentaire de Marine Sigismeau et Julien Fleurance, qui sortira à la fin de l’année porte bien son nom Kaloubadya. Entre tableaux artistiques, bande son travaillée, ce documentaire propose de suivre Marine, la réalisatrice, qui ouvre la parole dans sa famille et explore les mécanismes de traumatismes transgénérationnels. Sortie prévu en octobre-novembre 2025 sur Canal + Réunion.
Votre documentaire, Kaloubadya, traite des traumatismes transgénérationnels à travers votre propre histoire familiale. Comment ce projet est-il né ?
Julien Fleurance :
Marine et moi sommes cousins. Elle était en métropole et moi en Allemagne.
Tous deux artistes, nous avons chacun plusieurs casquettes : photographie, comédie, réalisation. Nous avons commencé à échanger autour de nos pratiques artistiques et, assez naturellement, une envie de créer ensemble est née. On s’est demandé ce que nous partagions. C’est là qu’on a identifié des problématiques communes — des angoisses, des moments de dépression — qu’on avait du mal à expliquer, qui nous pesaient, et qui semblaient dépasser nos histoires personnelles.
Marine Sigismeau :
C’est à partir de là qu’on a commencé, chacun de notre côté, un travail de recherche. J’ai commencé à interroger ma famille, à remonter mon arbre généalogique, à essayer de comprendre. Julien avait entamé une démarche similaire. On s’est rendu compte qu’on portait des choses anciennes, qui n’étaient pas nécessairement les nôtres. Cela faisait écho à des échanges que j’avais avec une amie thérapeute, Doris Volnay, praticienne réunionnaise en psychogénéalogie. Elle m’avait accompagnée pendant une période de dépression. Cette expérience a nourri nos discussions avec Julien et a mené à l’idée du documentaire : ouvrir la parole dans la famille, aller fouiller dans les zones d’ombre.

Kaloubadya, c’est un documentaire sur l’ouverture de la parole dans une famille, pour comprendre les nœuds hérités, trouver sa place et aller vers la résilience personnelle et collective.
Le film ne se limite donc pas à la question du traumatisme, il y a aussi une volonté d’ouvrir la parole ?
Marine Sigismeau :
Oui, exactement. On parle des traumatismes transgénérationnels, bien sûr, mais on cherche surtout à ouvrir un espace de parole au sein de notre famille. On explore l’histoire d’une famille réunionnaise, ce qui nous permet aussi de prendre du recul sur l’histoire de l’île. Ce recul apporte des clés de compréhension sur des blocages, sur des transmissions invisibles.
Pouvez-vous vous présenter chacun, et présenter brièvement votre famille ?
Julien Fleurance :
Je suis artiste pluridisciplinaire. J’ai commencé par la photographie et la peinture, en travaillant notamment sur les thématiques du corps et de la mémoire. Ensuite, je me suis tourné vers les problématiques liées à la colonisation, à l’esclavage et au post-colonialisme. Aujourd’hui, j’aborde ces sujets à travers la photographie, l’archivage, la peinture, sous forme d’expositions ou d’installations.
Marine Sigismeau :
Je suis née à La Réunion et je suis partie à 19 ans pour suivre des études artistiques. Je me suis dirigée vers le théâtre, le chant, puis la danse. J’ai beaucoup travaillé dans le spectacle vivant. De manière autodidacte, je me suis mise à la réalisation, autour du clip. C’est d’ailleurs comme ça qu’on a commencé à travailler ensemble.
Dans le documentaire, il y a trois tableaux artistiques, qui mêlent musique et image. Ils incarnent notre regard sur certaines histoires, avec un prisme de résilience.
Ce sont des moments de transformation : ouvrir la parole, libérer les émotions, et les transformer par l’art. C’est notre façon d’aborder la résilience, et ces tableaux sont une forme d’interprétation de notre histoire.
Dans le documentaire, nous avons filmé ma famille dite « nucléaire » : mes parents, mes frères et sœurs, un oncle, un cousin, deux grands-mères. On est originaires de Saint-Pierre. Lors de nos recherches généalogiques, on a remonté l’histoire jusqu’à Pierre Sigismeau, un esclave qui travaillait sur un domaine sucrier appartenant à la famille Orré. C’est là que le nom Sigismeau est apparu.
Aviez-vous dans votre famille des personnes déjà engagées dans une recherche généalogique, ou êtes-vous les premiers à vous y intéresser de cette manière ?
Julien Fleurance :
Je ne dirais pas qu’on est les premiers. On a poussé ces recherches, mais d’autres ont fait ce chemin, souvent de manière individuelle. C’est la première fois qu’on ouvre la parole et qu’on la partage.
Marine Sigismeau :
Ça dépend des gens. Certains étaient intéressés par ce travail, d’autres moins. Parmi nos cousins, certains avaient déjà commencé ce travail, d’autres pas du tout. Chacun a un rapport différent à cette histoire.
Comment avez-vous choisi les personnes à faire témoigner dans le documentaire ?
Julien Fleurance :
Il y a plusieurs personnages qui traversent le documentaire. On les a choisis en fonction de leur histoire, de leur rapport à la résilience, et de ce que cela pouvait dire de La Réunion.
Par exemple, la grand-mère de Marine a été mariée très jeune, à 14 ans. Elle a grandi dans les hauts de l’Entre-Deux, dans une famille modeste. On suit son parcours de jeune fille à grand-mère, et ce qu’elle traverse dit beaucoup de la condition des femmes à La Réunion, autrefois et aujourd’hui.
Marine Sigismeau :
On aborde aussi la place des pères, les deuils précoces, les relations mère-fille sur plusieurs générations. Et puis, il y a des histoires contemporaines : mon frère fait du trail, il explore l’île, s’enracine à sa manière. C’est une autre forme de résilience. Il y avait une volonté d’équilibre : ne pas montrer que le négatif, mais aussi ce qui donne de la force.
Le fait d’avoir quitté La Réunion vous a-t-il donné envie de reconnecter avec vos racines ?
Julien Fleurance :
Pas forcément. Ce chemin aurait pu se faire en restant ici. Il y a des personnes qui sont à La Réunion et qui font ce travail-là.
Marine Sigismeau :
En revanche, l’éloignement a réveillé une envie de remettre La Réunion au cœur de mon travail artistique. Certaines blessures auraient pu se vivre tout autant sur place. L’éloignement n’a pas été le déclencheur, mais il a joué un rôle dans la manière d’aborder ce retour.
Comment votre famille a-t-elle accueilli le projet ? Avez-vous rencontré des résistances ?
Julien Fleurance :
On a pris le temps d’accompagner les personnes qui participaient. Quand cet accompagnement était possible, cela s’est fait de manière fluide. On a eu l’impression que les femmes avaient souvent plus de facilité à ouvrir la parole. Les hommes, eux, ont parfois besoin d’un cadre, d’un accompagnement plus structuré. Il y a une question d’intimité, de ce qu’on peut ou non rendre public. C’était important aussi pour nous — et ça s’est fait naturellement — d’avoir un équilibre. Tout n’est pas que traumatisme.
Marine Sigismeau :
Mais chacun a été libre. On a expliqué notre démarche, ce qu’on voulait aborder, et les gens ont choisi ce qu’ils voulaient partager. Certains se sont retirés, d’autres se sont ajoutés. Tout s’est construit progressivement. On tenait à respecter la parole, sans rien forcer. Certains ont participé pour parler de sujets difficiles, d’autres de choses positives. On hérite aussi de beauté.
Vous ne prétendez pas être spécialistes du transgénérationnel. Quelle place donnez-vous à cette notion dans le film ?
Marine Sigismeau :
Le documentaire ne se positionne pas comme un travail de spécialiste du transgénérationnel. Ce n’est pas un film qui cherche à tout expliquer. On donne des pistes, on évoque certains sujets, mais on ne prétend pas faire le tour de la question. Le travail transgénérationnel, c’est quelque chose de très vaste, de très long, qui demande du temps, de l’accompagnement, et beaucoup de profondeur.
Nous, on propose une histoire personnelle, une démarche de compréhension à travers une famille. Le film suit Marine, qui essaie de comprendre sa place, d’interroger certaines choses, et qui donne la parole aux autres. Une thérapeute intervient, de manière ponctuelle, pour apporter quelques éléments, mais ce n’est pas un documentaire théorique. On s’en sert comme d’un outil. Ce qu’on donne, ce sont des clés, des fragments, pour donner du relief à une histoire intime.
Le documentaire est-il en créole ?
Julien Fleurance :
Certains témoignages sont en créole, d’autres en français. Cela dépend des personnes. Certains passent de l’un à l’autre. D’autres tiennent à garder le créole. Les musiques aussi sont en créole et en français.
Marine Sigismeau :
On a laissé chacun s’exprimer comme il le souhaitait. Certains étaient plus à l’aise en français, d’autres tenaient à s’exprimer en créole. C’était important de laisser cette liberté. On ne revendique pas un choix de langue : on laisse les gens parler comme ils se sentent à l’aise.
Vous avez insisté sur l’esthétique du film. Était-ce une priorité dès le départ ?
Julien Fleurance :
Oui. Marine et moi partageons une sensibilité esthétique. Nous avons prêté attention aux cadres, aux lumières, aux objectifs. Que ce soit dans les tableaux artistiques ou dans les interviews, l’image est soignée. L’esthétique est pour nous un outil de résilience.
Marine Sigismeau :
On veut que tout soit cohérent, que le film ne donne pas l’impression de passer d’un documentaire à un clip. C’est un seul Kaloubadya, on va dire.
Pourquoi ce titre, Kaloubadya ? Que signifie-t-il pour vous ?
Marine Sigismeau :
C’est un mot d’origine indienne, venu du Gujarat, qui désignait un commerce louche, une affaire de sorcellerie. À La Réunion, c’est devenu un mot pour dire “un bazar”, “un gros mélange”.
Quand j’ai commencé à interroger ma famille, j’ai eu l’impression d’un gros bordel pas clair, parce qu’on ne communique pas beaucoup de base. Ce mot décrit bien ce qu’on a voulu explorer. L’histoire familiale, mais aussi celle de La Réunion, est un kaloubadya.
Avez-vous eu l’impression de réussir à faire parler des gens qui, jusque-là, restaient silencieux ?
Julien Fleurance :
Je ne dirais pas qu’on ne communique pas beaucoup. On communique, mais pas toujours de manière concrète ou authentique. Dans la culture créole, on ne revient pas facilement sur ce qui a fait mal. « Gramoun y parle pas ». On a eu la chance d’avoir des personnes qui voulaient se livrer. On est tombés au bon moment.
Marine Sigismeau :
Les anciens parlent peu du passé. « C’était le tan lontan. » Ils avancent, sans forcément revenir dessus. Si on ne pose pas de questions, ils ne racontent pas. C’est là que notre démarche prend tout son sens.
Il y a des choses difficiles, mais aussi de très belles. Les gens nous ont montré leur résilience.
Faites-vous des liens historiques dans le film ?
Julien Fleurance :
Le documentaire est chapitré. Dans certains chapitres, on évoque des faits historiques. Par exemple, sur le désengagement des pères : pendant l’esclavage, les hommes n’avaient pas le droit de reconnaître leurs enfants. Ce genre d’élément éclaire certaines situations familiales. On ne fait pas de raccourcis, mais on montre que l’histoire intime résonne avec l’Histoire.
Si vous deviez résumer Kaloubadya en une phrase ?
Marine Sigismeau :
Kaloubadya, c’est un documentaire sur l’ouverture de la parole dans une famille, pour comprendre les nœuds hérités, trouver sa place et aller vers la résilience personnelle et collective.
Qu’aimeriez-vous que le public retienne du film ?
Julien Fleurance :
On espère que les gens y trouveront quelque chose qui résonne. On ne dit pas : allez interroger vos grands-parents. Mais si quelqu’un sent que c’est le moment, alors peut-être que le film l’aidera.
Marine Sigismeau :
Ce documentaire dit aux Réunionnais : OK, on a une histoire belle mais complexe, mais il existe plusieurs manières de se libérer. Par l’art, le sport, la montagne, la spiritualité, la religion… Le film propose quelques clés. Chacun avance comme il le peut.
Parlez-vous de la relation aux ancêtres, des pratiques spirituelles ?
Julien Fleurance :
Oui. On montre une prière aux ancêtres, avec notre oncle et notre cousin. Ils ont repris ces pratiques oubliées dans la famille et elles font désormais partie de leur quotidien.
Ce projet a-t-il été cathartique pour vous ?
Julien Fleurance :
On a vu qu’il y avait de grandes forces. Il y a des choses difficiles, mais aussi de très belles. Il y a eu des moments d’émotion, de difficultés, mais aussi de la réunification. Les gens nous ont montré leur résilience.
Marine Sigismeau :
Ça touche à ma famille proche. Ce n’était pas toujours évident. Il y a eu un effet libérateur, même si certaines choses ne guérissent pas — et c’est OK. Ce documentaire ne résout pas les choses. Il montre, il propose, il ouvre. C’est une étape.
Vous avez également travaillé avec plusieurs artistes pour la musique. Qui sont-ils ?
Marine Sigismeau :
On a collaboré avec Nathalie Natiembé, Stéphane Lepinay, Muriel Turpin (Mù), Boogz Brown, Sully Doro et Thomas Lim-Su-Kwaï (Eleska). Avec Eleska et Julien, on va aussi proposer une version revisitée de la chanson Caloubadia d’Alain Péters.
C’est important de citer les artistes, parce qu’ils se sont approprié le documentaire et ont donné une autre lecture du film.
Quand sortira le film ?
Il est produit dans le cadre de l’appel à projets « S’engager pour l’avenir » de Canal+ Réunion. Il devrait sortir fin 2025, probablement en octobre-novembre.
Entretien : Léa Morineau
Photo mise en avant : Zévi Studio©
Directeur de la photographie : Gwenaël BERTAUT
Cadreurs : Jonas METANIRE et Willy VINGADACHETTY
Ingénieur son : Léandre DALLERY
Production : Nawar et Sanosi