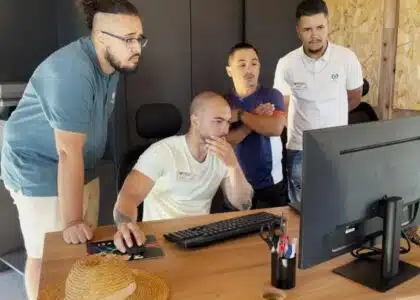Parallèle Sud continue son questionnement pour comprendre où en est le créole à La Réunion. Nadia Sintomer, professeure des écoles et militante culturelle au sein du MLK, poursuit l’engagement de son père Franswa et parle du travail qu’il reste à faire pour donner sa pleine place à la langue et la culture créole.
Q : Aujourd’hui tu es professeure des écoles et tu milites pour donner plus de plus à la culture créole. Est-ce-que ton engagement vient de histoire familiale ?
R : Oui, très clairement. Mon père, Franswa Sintomer, était un militant culturel de longue date : radio, transmission du créole, tisanes, médiation… C’est en s’exilant dans l’hexagone qu’il a compris l’importance de ses racines et aussi leur fragilité. Quand j’étais ado, je me suis éloignée du créole, mais plus tard, en faisant des sciences du langage et en me spécialisant en créolistique, tout m’est revenu.
À sa mort, j’ai repris l’association et ses dossiers. Depuis trois ans, je participe aussi à un collectif d’une trentaine d’associations pour construire un plan d’enseignement de la langue et de la culture créoles à l’école.
Q : Comment utilises-tu le créole en classe ?
R : Le créole est présent tous les jours, sauf quand j’enseigne spécifiquement le français. En maths, découverte du monde, activités du quotidien : on part naturellement en créole. Pour moi, l’essentiel, c’est la compréhension. En grande section/CP, nous fonctionnons même en trilingue : français, créole, anglais.
Et ça marche : les enfants écrivent dans les trois langues. Toutes les études montrent que le bilinguisme ne pose aucun problème. Au contraire, il renforce l’apprentissage du français.
Q : Et au sein de l’équipe, le créole est accueilli de la même façon ?
R : On est quatre enseignants habilités pour le créole. On partage les mêmes valeurs, mais l’application diffère : par exemple, l’accueil des élèves en maternelle devrait se faire dans la langue de l’enfant. C’est inscrit noir sur blanc dans les préconisations. Dans les faits, ce n’est pas toujours appliqué. C’est symptomatique de ce qu’on vit : les textes existent, mais la réalité ne suit pas.
Q : Enseigner dans les hauts, à Bras-Sec ou à Cordes, ça change quoi ?
R : L’isolement crée une proximité incroyable. On connaît les familles, les enfants, leur histoire. Ça aide énormément, surtout sur la question de la langue : beaucoup de parents ont encore l’idée que « le créole fait échouer ». Parce qu’on se connaît, on peut rassurer, accompagner, expliquer.
L’isolement, finalement, devient un atout.
Q : Où est-ce-qu’on en est au niveau des outils pédagogiques pour donner sa place à la langue et à la culture créole?
R : Il manque tout. Pas de manuels, pas de ressources prêtes à l’emploi, pas de cartes, pas de supports d’histoire adaptés à La Réunion. En Corse, les manuels nationaux sont tous traduits. Ici, rien. Pour l’histoire, on est rangés dans “l’histoire des colonies”, mais il n’existe aucun manuel pour raconter et expliquer notre histoire, notre territoire. On doit donc tout créer nous-mêmes.
Q : Selon toi, la langue, l’identité, la culture : on peut les dissocier ?
R : Non. La langue porte l’identité. Elle porte la culture. Elle explique l’histoire. Si on ne la met pas au centre, on crée de l’incompréhension, et ça renforce les tensions sociales. La cohésion sociale passe aussi par la reconnaissance de soi. Quand un enfant sait qui il est, il peut avancer.
Q : Le rectorat en fait-il assez pour l’application de la loi Molac de 2021 qui régit l’apprentissage des langues régionales ?
R : Selon moi, la loi Molac qui impose un cours de langue régionale une fois par semaine n’est pas respectée. Nous sommes d’ailleurs le seul département de France à ne pas l’appliquer. En vingt ans, à peine 1 % des enfants ont eu un enseignement structuré du créole.
Avec trente associations, nous avons travaillé pendant deux ans sur un plan complet pour l’enseignement de la langue et de la culture réunionnaises (PELCR) : progressions, objectifs, contenus, outils, formation. On s’est inspirés des modèles corse, breton, basque. Mais le rectorat refuse de l’adopter en bloc, il considère que le projet est politique alors qu’il s’agit d’un projet qui parle d’éducation. Il veut prendre « des morceaux ». Nous, on refuse le saucissonnage : une langue, ça demande une cohérence pédagogique et c’est ce qu’on a essayé d’apporter tout au long de la construction de ce projet.
Le rectorat multiplie les événements ponctuels – journée créole, semaine des langues… – mais sans suivi, sans vision.
En vingt ans, à peine 1 % des enfants ont eu un enseignement structuré du créole.
Q : On parle souvent de “créoles contre zoreils”. C’est le vrai problème ?
R : Pas du tout. Le recteur est zoreil, mais les inspecteurs sont créoles, très compétents, très conscients des enjeux. Ce n’est pas une question d’origine : ce sont des visions de la société qui s’opposent.
Je ne veux exclure personne. Je veux qu’on construise un citoyen réunionnais, avec toutes ses composantes : langue, histoire, traditions. Si je prends mon histoire personnelle, je suis moitié zoreil moitié créole et si je ne suis pas en recherche de légitimité, je suis toujours en questionnement : quelle aurait été mon identité si mon histoire, ma culture avaient été plus présent dans ma construction? Inconsciemment, le fait d’avoir eu une identité minorée, colonisée, ça crée pas des citoyens hyper dignes.
C’est un travail de médiation, d’explication. Oui, c’est difficile : on se fait vite taxer de raciste ou d’extrémiste, alors qu’on veut simplement clarifier les choses.
Inconsciemment, le fait d’avoir eu une identité minorée, colonisée, ça crée pas des citoyens hyper dignes.
Q : Tu n’as pas peur qu’une telle position soit mal perçue?
R : Oui, certains me trouvent “trop tiède”. Mais je pense qu’on va tous dans le même sens. Il faut cesser de se diviser. C’est déjà assez compliqué comme ça.
Je crois profondément à la pédagogie, au fait de créer des ponts et de calmer les tensions. Mais c’est fatigant : dès qu’on parle d’histoire, de créole, d’identité, certains s’énervent vite. Je reste convaincue qu’il faut continuer à expliquer, à améliorer la mise en avant de la culture réunionnaise dans sa globalité.
Q : Parlons du MLK, le Mouvant Lantant Koudmin. Quel est le cœur de l’association aujourd’hui ?
R : Nous avons cinq objectifs : l’apprentissage de la langue (ateliers, traductions et sensibilisation), les tisanes (transmission des savoirs traditionnels), le planter pour manger (autonomie alimentaire), le maloya avec notre groupe Maronèr et la défense du drapeau réunionnais aux cinq couleurs créé par mon père.
On s’est réparti les rôles : moi, je me charge de la langue.
Q : Justement, raconte-nous l’histoire du drapeau.
R : Mes parents voyageaient beaucoup. Dans les années 1980, au Canada, mon père voit des drapeaux partout et dit : « C’est ça qu’on doit avoir à La Réunion : un symbole à brandir. » Il crée alors le drapeau aux cinq couleurs : noir pour l’esclavage, rouge pour le volcan, jaune pour le solei, bleu pour la mer et vert pour la nature et l’espoir.
Les cinq couleurs symbolisent aussi les cinq grandes origines du peuple réunionnais. Il a participé au concours du drapeau (face au Mavéli), il n’a pas gagné, mais il a continué en disant : « 200 personnes ne représentent pas La Réunion ». J’ai fait protéger officiellement son drapeau à l’INPI. Je suis très heureuse de voir des actions qui mette en avant ce drapeau comme cela a été le cas récemment et surtout, je suit la ligne de mon père, celle de ne pas opposer les drapeaux. Pour lui ce qui était important, c’était de parler de La Réunion.
Q : On dit souvent : “le créole est une langue vivante ». Alors pourquoi s’inquiéter ?
R : Une langue vivante peut aussi s’éroder. On croit que tout va bien parce que beaucoup de gens parlent créole. Mais tous ne le transmettent pas, et on ne propose aucun apprentissage pour ceux qui veulent l’apprendre.
Un zoreil peut vivre quinze ans ici sans pouvoir se présenter en créole. Parce qu’on ne propose aucun cours, nulle part. Même l’Office de la Langue ne le fait pas. C’est un vrai problème.
Dans les années 1980, au Canada, mon père voit des drapeaux partout et dit : « C’est ça qu’on doit avoir à La Réunion : un symbole à brandir. » Il crée alors le drapeau aux cinq couleurs : noir pour l’esclavage, rouge pour le volcan, jaune pour le solei, bleu pour la mer et vert pour la nature et l’espoir.
Q : Et les classes bilingues ?
R : Elles sont essentielles. Si ce n’est pas l’école qui transmet la langue, la culture, les pratiques… alors ce n’est pas la famille qui pourra le faire, surtout aujourd’hui. Paradoxalement, c’est dans l’ouest – où il y a beaucoup de zoreils – qu’il y a le plus de classes bilingues. Comme quoi : tout le monde y gagne. Le PELCR a d’ailleurs été réfléchie comme un plan qui regroupe tout ce qu’il est possible de mettre en place pour favoriser l’apprentissage dans des classes bilingues.
Jean-Louis Robert parle de diglossie, mais nous au sein de l’association, on parle carrément de génocide linguistique parce que ça fait vingt ans qu’on parle des problèmes d’alphabétisation, des difficultés pour les marmay de parler le français mais on met trop souvent de côté la langue créole qui encore une fois pour citer Jean-Louis Robert n’est pas une languèt mais une langue à part entière et langue maternelle pour de nombreux habitants de La Réunion encore aujourd’hui.
Donc oui pour le bilinguisme positif, qui valorise les deux langues sans que l’une n’efface l’autre ou que l’une soit au service de l’autre.
Q : L’option créole a été supprimée récemment. Une réaction ?
R : Alors effectivement, si on regarde le problème dans sa globalité, il y a aussi un problème de candidat à l’option créole car ils sont de moins en moins nombreux voir inexistants.
Cela n’empêche que la suppression de l’option langue créole pour l’agragation 2026 ça reste inquiétant. On nous dit : « On verra dans les prochaines années. » Moi, je pense qu’il faut agir maintenant. Si on ne protège pas la langue aujourd’hui, demain il sera trop tard.
Mais ça démontre ce que l’on dit : si on ne valorise pas la langue, on ne donne pas envie aux jeunes de s’y intéresser donc peu auront envie d’en faire leur métier.
Propos recueillis par Olivier Ceccaldi