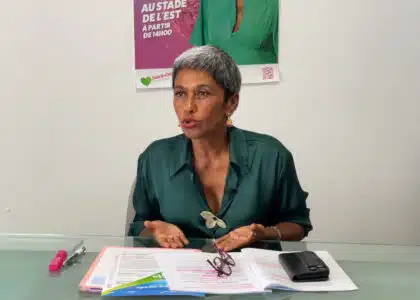TROISIÈME ÉPISODE / DE 1955 À 1969 : REVENDICATION AUTONOMISTE ET MARGINALISATION#
Les sixties sont décrites comme les années mythiques de Paul Verges. Devenu ennemi intime de l’homme d’État Michel Debré, le leader communiste autonomiste prend le maquis et défie les autorités. Les militants voient en lui un chef suprême, voire plus. Mais dans les urnes, l’ex-député est contraint à la diète.
Conseiller général de Saint-Paul, député de La Réunion, directeur de Témoignages, Paul Verges s’impose vite comme le leader du parti communiste autant grâce au coup de pouce de son père que grâce à son activisme. En décembre 1955, il est désigné tête de liste pour les législatives du mois suivant. Le préfet Pierre Philip le décrit ainsi dans un courrier envoyé au ministre de l’Intérieur: «Paul Verges, formé aux écoles de cadres communistes, est dangereux et peut éventuellement entraîner ses auditeurs à l’action directe (…). Il commence à comprendre que les thèmes des écoles du parti et la violence pure ne produisent guère d’effet à La Réunion. Il s’adapte, essaye de faire rire ses auditeurs et prononce quelques phrases en créole selon la méthode employée avec succès par M. Lepervanche.»
Les 17 et 18 mai 1959, des portraits de François Coupou et Eliard Laude, deux militants « assassinés» en 1958 et 1959 lors de violentes campagnes électorales, décorent la tribune de la conférence constitutive du PCR. Lors des élections municipales de mars 1959 à Saint-Denis remportées par Gabriel Macé, le candidat Paul Verges est lui-même frappé : «Mes enfants ont tout vécu, ils m’ont vu assommé sur un trottoir de Saint-Denis.»
Défendre les «nationaux» contre les « séparatistes»#
La droite sort l’artillerie lourde. Le général de Gaulle, devenu président de la République, effectue une visite officielle dans l’le les 9 et 10 juillet en compagnie de son Premier ministre Michel Debré, qui n’imagine pas alors l’ampleur de son destin créole. De 20 000 à 30 000 Réunionnais enthousiastes les accueillent au stade de la Redoute.
Mais les deux dirigeants nationaux entendent aussi les quelques militants communistes qui dénoncent les fraudes électorales. Le général lance alors un célèbre: « Ah! Oui, vous êtes français, vous êtes français, par excellence, vous êtes français passionnément… Réunionnais, vous occupez dans cet océan une position française.»
Et c’est avec cette même passion que l’appareil d’État entend défendre les « nationaux» contre les « séparatistes» en concoctant, par exemple, la fameuse ordonnance du 15 octobre 1960 dont Michel Debré revendique « la volonté, la rédaction et l’application». Il s’agit, ni plus ni moins, sur simple appréciation du préfet de « muter d’office, et sans appel possible, en France tout fonctionnaire jugé dangereux pour la sécurité du département».
Ainsi sont éliminés du jeu politique local de nombreux dirigeants du PCR dont Gervais Barret, Boris Gamaleya, Bernard Gansarsky, Jean Le Toullec, Jean-Baptiste Ponama, Max Rivière, Roland Robert, Pierre Rossolin…
Paul Verges n’étant pas fonctionnaire, ne peut être muté. Néanmoins, à partir du 30 mai 1961, date de la première saisie de Témoignages, il est constamment poursuivi en justice en tant que directeur du journal. Il est même retenu en métropole quelques semaines sur ordre du gouvernement pour d’obscures raisons de sécuriteé en vertu de la loi sur l’état d’urgence. Mais Perreau-Pradier, qui rêve alors dans ses rapports aux ministres d’une « dissolution du PCR», touche aux limites de son engagement. Il est même condamné en janvier 1962 à dédommager Témoignages en lui restituant les exemplaires saisis en plus de 25 000 francs de dommages et intérêts.
Contre Debré « sans se faire de cadeau»#
Les élections législatives de 1962 sont annulées suite à une fraude flagrante et massive. Le risque d’une victóire de Paul Vergès face à une droite désunie lors des élections partielles de 1963 est si grand que le sénateur Repiquet prend la tête d’une délégation pour demander à Michel Debré de venir au secours de la droite réunionnaise. Le rédacteur de la Constitution de la Ve République vient de subir un échec électoral à Blois.
En accord avec le général de Gaulle, il accepte la mission. Tous les journaux, excepté Témoignages, le soutiennent ouvertement, ainsi que le clergé et le monde économique. Le 5 mai 1963, il est élu avec plus de 80% des voix face à un Paul Vergès décrit comme le communiste aux ordres de Cuba et de Moscou.
Objectivement, Michel Debré obtient alors les moyens financiers permettant un début de rattrapage des retards structurels accumulés par le jeune département. Mais les crispations idéologiques atteignent leur paroxysme. « Pendant près de trente ans, on s’est battu sans se faire de cadeau. C’est le moins qu’on puisse dire », commente Paul Verges.
Perreau-Pradier a été remplacé mais le député «bon zoreil» cherche lui aussi tous les moyens juridiques pour barrer la route au leader communiste qui est poursuivi pour divers délits de presse, pour avoir prôné l’autonomie et pour avoir accusé le pouvoir de fraude et de violence électorale par l’emploi de nervis.
Le mythe de l’homme invisible#
Le 16 mars 1964, Paul Vergès écope en appel de trois mois de prison ferme. Les juges reprochent à Témoignages la reproduction d’articles parus dans Le Monde et L’Humanité sur la répression en Algérie et les noyades de manifestants algériens dans la Seine le 17 octobre 1961. Paul Vergès refuse de se rendre. Le 17, les policiers viennent le chercher chez lui mais ils butent sur une porte close. Le 18, le conseil général démissionne d’office Paul Vergès de son mandat portois.
Le 19, la Une de Témoignages explique: « Paul Vergès devait être arrêté lundi! Dans une lettre adressée au procureur géneral, notre camarade déclare: Je ne puis accepter d’accomplir ma peine tant que tous les fraudeurs inculpés à la suite de mes plaintes ne seront pas eux aussi jugés.» Ainsi débute «l’affaire Vergès», le maquis, la cavale, le marronnage.

Pendant 28 mois et 10 jours, le secrétaire général du PCR se joue des forces de l’ordre lancées à sa poursuite. Les militants paient des «cartes de solidarité» pour financer la cavale. Le fugitif bénéficie de complicités multiples, y compris de la part d’un « vieux copain» qui était un adversaire politique.
Il tient des meetings clandestins partout dans l’ile, rencontre ses proches malgré la surveillance policière, se fait même soigner chez un dentiste gaulliste, M. Sishaye.
Un véritable mythe, celui de l’homme invisible aux pouvoirs extraordinaires, voit le jour. « Il y a un Invisible actuellement à La Réunion », écrit Témoignages le 26 décembre 1964. Quand la police le recherche à Saint-Denis, il est au Port.
Quand elle le recherche au Port, il est aux Colimaçons. Il circule en voiture à côté d’un chauffeur mais quand la police arrête la voiture, il disparaît. Les plus admiratifs n’hésitent pas à le qualifier de « Bon dié la terre».
Non-lieu pour l’autonomiste#
Lorsque le 28 juillet 1966, il se rend de son plein gré dans le bureau du procureur, Paul Vergès sait que la loi d’amnistie du mois précédent a effacé sa peine de trois mois de prison ferme pour les délits de presse. Cependant, il doit encore, après un bref passage en détention, aller s’expliquer devant la Cour de sûreté à Paris pour « atteinte à la sûreté du territoire national» à cause de sa revendication d’autonomie de La Réunion.

Son transfert vers la métropole déclenche une nouvelle polémique. La préfecture s’oppose à un transport aérien, suspectant le colonel Nasser de tenter de libérer le rebelle lors de l’escale obligée du Caire. Rappelons que l’Organisation des Nations unies a classé La Réunion parmi les pays restant à décoloniser. Les communistes, quant à eux, craignent qu’un long voyage en bateau ne permette à «certains milieux» d’organiser son assassinat comme ont été éliminés l’Algérien Ben Barka et le Camerounais Félix Moumié.
Paul Vergès fait une grève de la faim de deux jours pour échapper au bateau. Le 31 juillet, accompagné par une foule de supporters, il est finalement mis dans l’avion. Dix jours plus tard il est libéré mais placé sous résidence surveillée à Paris. « J’ai développé devant la Cour de sûreté notre droit à demander plus de compétences en m’inspirant de l’esprit et de la lettre des engagements du général de Gaulle qui, sur la base de la Constitution, avait institué le pouvoir autonome du Rocher Noir sur les trois départements français d’Algérie et avait consulté les Algériens lors du scrutin d’autodétermination. Et j’ai obtenu un non-lieu (le 6 mai 1968) qui a fait jurisprudence en faveur des Martiniquais», commente-t-il en rappelant, non sans malice, que 45 ans plus tard, le président Sarkozy évoque sans tabou l’autonomie lors de ses discours pour l’outre-mer.
Le 21 décembre 1966, Paul Vergès rentre à La Réunion. La «comédie politico-policière» se termine. Le leader du PCR a fait sa cure de proximité avec les masses populaires. Il a affûté sa dérision de l’adversaire, l’une de ses armes politiques préférées.
Souffrance familiale#
Il s’est inscrit dans la lignée des esclaves marrons. Mais lui aussi a intérêt à ce que cette cavale s’achève car les résultats électoraux du PCR en souffrent. Son poids dans les urnes a diminué de moitié, les bastions du Port et de La Possession ont basculé à droite et lors de la présidentielle de 1965, de Gaulle, soutenu par Debré, a raflé plus de 91% des suffrages.
La souffrance familiale ne peut pas être sous-estimée non plus. « Laurence a vécu des moments dramatiques, confie Paul Verges. Mes enfants ont certainement énormément souffert de cette période avec un père recherché et absent, des campagnes de presse, une surveillance policière constante, des perquisitions de la police et de la gendarmerie.
Leur vie, à l’école comme avec leur mère, a été certainement très dure. Des années après, j’ai trouvé un texte de Laurent qui faisait allusion aux méthodes policières qui l’avaient traumatisé. J’ai conscience de ne jamais pouvoir rendre à ma famille ce qu’elle a subi pour moi.»
Textes : Franck Cellier
1959 : Le PCR remplace le PCF#
Le Parti communiste réunionnais est fondé le 18 mai 1959. En rupture avec la métropole Paul Vergès prône (déjà) le front le plus large.
À la fin des années cinquante, la montée de l’anticommunisme, personnifiée et institutionnalisée par le préfet Perreau-Pradier, renforce la détermination de Paul Vergès à faire avancer les thèses anti-coloniales qui l’ont animé jusqu’alors, ne serait-ce que par son voisinage avec les leaders du Rassemblement démocratique africain.
Il peut être facile, dans le cadre d’une telle bipolarisation — anticommunistes contre anticolonialistes — de voir dans le jeune député un dangereux indépendantiste qui rêve d’un destin alliant Madagascar, indépendante en 1960, et La Réunion. Mais c’est oublier la priorité que donne Paul Vergès à l’analyse.

Une philosophie qu’il résumait ainsi en janvier 2011: « On peut toujours s’intéresser aux tactiques immédiates mais je préfère réfléchir sur l’avenir. Moi, je suis très serein: je suis sûr de gagner parce que je réfléchis à une période historique. »
Dans le sillage de la Martinique#
Le propos, pour péremptoire qu’il soit, explique pourquoi un parti communiste a pu garder une telle influence après la faillite mondiale de cette idéologie et pourquoi ce même parti a survécu au renoncement à son mot d’ordre d’autonomie: tout simplement parce qu’il a l’obsession de s’adapter sans cesse au contexte au point d’être finalement le «Parti Central de La Réunion», plus que son parti communiste. L’expression est d’Yvan Combeau et elle plaît à Paul Vergès.
En 1959, les communistes réunionnais font le constat de l’échec de la départementalisation. L’idée de créer un parti communiste réunionnais n’a en fin de compte rien d’original. À l’époque, elle est soutenue par les dirigeants du PCF et s’inscrit dans le sillage déjà tracé par Aimé Césaire qui fonde le parti communiste martiniquais le 22 septembre 1957. Le parti communiste guadeloupéen voit le jour l’année suivante.
« La discussion fut passionnée»#
Mais dès sa constitution, le 18 mai 1959, le PCR tend vers un rassemblement plus large que les seuls communistes, c’est en tout cas le projet que défend Paul Vergès lors des différentes réunions qui précèdent la création du PCR. La vieille garde, menée par Léon de Lepervanche, affiche alors sa réticence quant à une séparation du PCF.
L’élargissement de l’organisation à des non-communistes constitue un second obstacle.
« La discussion fut passionnée », écrivait Témoignages le 20 mai 1959 à propos des débats sur le passage du PCF au PCR, « instrument décisif entre les mains des travailleurs et du Peuple réunionnais pour leur libération du joug colonial » (Une de Témoignages du 19 mai 1959).
Trois décennies plus tard, le livre de Paul Vergès D’une île au monde évoque quant à lui un « compromis pourri ». Par cette « expression terrible», le leader du parti parle de désaccord stratégique avec Léon Feix, responsable du PCF pour l’outre-mer.
Ressusciter le Crads#
Le métropolitain s’oppose fermement à la création d’un « front très large » alors que Paul Vergès plaide pour ressusciter l’esprit du Crads de 1945. Il en a même déjà choisi le nom: le Parti réunionnais de la liberté (PRL).
Ce petit rappel historique explique l’obsession vergésienne, par la suite, de former des rassemblements et des alliances s’appuyant sur les bases électorales du PCR et atténue l’image caricaturale du communiste soviétique qu’ont souvent dessine ses plus farouches adversaires.
Toujours est il qu’un compromis, même « pourri », était nécessaire, selon Paul Verges, car, dit-il, « on ne pouvait pas dans les conditions de répression de 1959, se permettre d’échouer dans notre volonté d’arriver à une organisation, le PCR, dirigée par les Réunionnais eux-mêmes ». L’adversité propre à cette époque de guerre froide permet au PCR de se renforcer… et à Paul Vergès d’écrire sa légende.
Mais une fois la diabolisation épuisée, il faut rechercher de nouveaux alliés, condition sine qua non pour conquérir des postes de responsabilité au-delà des bastions communistes.
Le PCR doit être un « instrument décisif » entre les mains des travailleurs et du peuple réunionnais pour leur libération du joug colonial.
ENTRETIEN AVEC PAUL VERGÈS…#
« Les défenseurs de la liberté d’opinion »#
Morceaux choisis d’un journal de cavale. Entre clandestinité et immersion dans la « vraie» population réunionnaise..
« J’ai eu la chance d’être directeur de Témoignages et, à ce titre, d’avoir vécu les 43 saisies du journal et la répression qui m’a valu des condamnations à des mois de prison et m’a poussé à la clandestinité. J’ai pu bénéficier d’une solidarité populaire, politique et financière extraordinaire pendant 28 mois.
J’ai ainsi été en contact étroit avec la réalité populaire réunionnaise qui m’a montré que les réflexions que nous avions eues en 1959 se vérifiaient sur place dans la lutte contre l’oppression et les fraudes électorales qui nous avaient enlevé nos municipalités les unes après les autres : Bras-Pa-non, Saint-André, Sainte-Marie, Saint-Denis, le Port, la Possession, Saint-Paul, Saint-Leu…
« J’ai découvert le rôle du maloya »#
J’étais marié, j’avais déjà quatre enfants tout jeunes. Sans la solidarité populaire, je n’aurais pas pu rencontrer régulièrement, comme je le faisais, mes enfants et ma femme même s’il y avait tous les gendarmes et tous les policiers à mes trousses. J’étais à Grand-Bois dans les champs et c’est là que j’ai découvert le rôle du maloya, son caractère vivant et son caractère contestataire.
Si on veut voir un peu les raisons pour lesquelles le PCR gardait cette influence, c’est que pendant toute cette période, allant de la fin des années 1950 aux années 1970, nous avons personnifié ici la défense de la liberté sur tous les plans.
« Assommé par les CRS »#
L’expérience populaire profonde pendant des décennies a montré que face à toutes les campagnes contre les communistes nous étions les défenseurs de la liberté d’opinion. Quand vous êtes saisi 43 fois, que vous êtes condamné à des mois de prison pour délit de presse, quand vous combattez l’ordonnance Debré d’octobre 1960 contre l’exil des gens, quand vous défendez les religions opprimées ici par rapport à l’héritage colonial, quand vous défendez les jeunes syndicalistes, vous personnifiez aux yeux des gens la défense de la liberté sur tous les plans.
Toutes les campagnes menées contre nous se heurtent encore aujourd’hui à cette image qui est restée dans la conscience populaire.
J’ai été candidat dans toute l’île au cours d’élections très violentes. Quand je gagne les élections municipales de 1959 à Saint-Denis, et la démonstration avait été faite que j’avais gagné, eh bien je finis sur un trottoir de la rue de Paris, assommé par les CRS. »
Commémoration#
Non à l’oubli ! Paul Vergès aurait eu cent ans le 5 mars dernier. Pour l’heure, seul le Parti communiste réunionnais, qu’il a fondé, appelle à commémorer ce centenaire en invitant à une réflexion approfondie sur la pensée de l’ancien président de Région. Conscient de l’oubli dans lequel sombre ce siècle écoulé, Parallèle Sud réédite en plusieurs épisodes le récit de la vie de Paul Vergès de 1925 à 2016. Ces textes de Franck Cellier sont aujourd’hui introuvables dans les archives du Quotidien qui les avait publiés le 13 novembre 2016.
LES SOURCES#
Ce récit de la vie de Paul Vergès a été écrit à partir des informations que Paul Vergès lui-même ainsi que d’autres ont pu délivrer ces vingt-huit dernières années au fil de l’actualité. Mais également grâce aux travaux de journalistes, écrivains et universitaires :
- Le documentaire « Le grand échiquier » (2007) de Bernard Gouley et Christophe Debuisine ;
- « Vergès père, frères et fils. Une saga réunionnaise » (2007) de Robert Chaudenson ;
- « Le Mémorial de La Réunion » (1989) ;
- « D’une île au monde », entretiens avec Brigitte Croisier ;
- « Ban-bai, Raymond Vergès » de Chantal Lauvernier ;
- « Vergès et Vergès, de l’autre côté du miroir » (2000) de Thierry Jean-Pierre ;
- « Vergès, le maître de l’ombre » (2000) de Bernard Violet ;
- « Le syndicalisme à La Réunion de 1900 à 1958 » (1987) de Prosper Eve ;
- « La vie politique à La Réunion » (2003) d’Yvan Combeau ;
- « Michel Debré et l’île de La Réunion » (2006) de Gilles Gauvin ;
- « Réunion politique : départementalistes contre autonomistes » (2011) de Frédéric Payet.
- La rubrique « histoire » du site internet mi-aime-a-ou.com…
- En janvier 2011, Paul Vergès nous avait accordé un long entretien au cours duquel il avait retracé l’ensemble de son parcours.
- De nombreuses photos de la vie de Paul Vergès ont été collectées et publiées sur le site 7 Lames la Mer