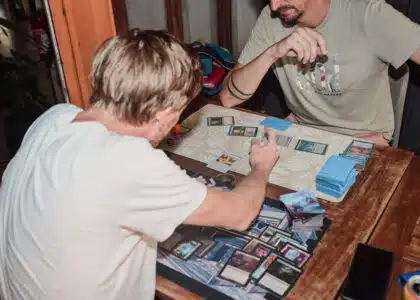À la Maison Serveaux à Saint-Paul, du 10 au 28 mars, a été exposé le travail de la photographe Marie Manecy. Fruit d’un partenariat avec la maison de santé pluriprofessionnelle SENS et la ville de Saint-Paul, cette exposition intitulée « Voyage intérieur » porte un nouveau regard sur l’endométriose, maladie encore peu connue. Parallèle Sud y a découvert l’exposition et a rencontré la photographe ainsi que l’une des participantes.
Ce projet est né de la collaboration entre Marie Manecy et la maison de santé SENS de Saint-Gilles-les-Hauts, avec le soutien financier de la ville de Saint-Paul. Dans le cadre du parcours Endo Sens, qui vise à accompagner les patientes souffrant de la maladie, plusieurs ateliers individuels et collectifs de compréhension de la maladie, sur le lien entre fertilité et sexualité dans l’endométriose ou encore un atelier diététique ont par exemple été proposés pour les femmes atteintes de la maladie, aux côtés de l’atelier photographique de Marie Manecy. Deux femmes ont été invitées à rejoindre le projet, par l’association Endo-Espoir. Après deux mois de photographie, l’exposition est l’aboutissement d’un processus créatif, mais aussi thérapeutique.
Lorsque l’on entre dans l’espace photo, la bande-son tourne déjà. On y entend des extraits de témoignages de femmes atteintes d’endométriose, qui parlent de la maladie, sur fond d’un morceau de piano dont la mélodie transpire l’espoir et la sensibilité.
Les premières photos affichées proposent aux visiteurs de plonger directement dans l’univers de la maladie.


L’endométriose, l’histoire d’une maladie longtemps méconnue#
Pour rappel, cette maladie, qui touche environ une femme sur dix, est définie par l’Institut Pasteur comme « une affection gynécologique chronique dans laquelle le tissu qui tapisse normalement l’utérus, appelé l’endomètre, se développe en dehors de celui-ci. Cette condition peut entraîner divers symptômes douloureux, affectant la qualité de vie de la personne, ainsi que des problèmes de fertilité. »
Florence Mirsaëb est l’une des huit participantes au projet. Elle aussi atteinte d’endométriose, elle me décrit la maladie avec ses mots : « L’endométriose est une maladie chronique inflammatoire qui, dans les cas les plus avancés, peut être invalidante. Les douleurs se localisent dans la zone gynécologique mais peuvent aussi se manifester dans le dos, les bras et les jambes. On a de plus en plus d’études qui permettent de mieux comprendre cette maladie, mais pendant longtemps, on en savait très peu sur le sujet. »

Des douleurs accompagnées de culpabilité#
Une méconnaissance de la maladie qui, pendant longtemps, a ajouté sur le dos des femmes atteintes un poids de culpabilité et d’incompréhension. En témoignent les premières photos qui abordent la solitude qu’ont pu ressentir ces femmes au moment de lire les notices des médicaments prescrits par le corps médical, au format A5, sans rien y comprendre.
« J’ai vécu 15 ans d’errance médicale, car j’ai eu mes premières dysménorrhées (douleurs menstruelles) à l’âge de quinze ans, et j’ai dû attendre mes trente ans pour avoir un diagnostic. Pendant longtemps, à l’hôpital, on me disait que c’était dans ma tête, qu’il fallait que j’arrête de venir à l’hôpital tous les mois, car c’était pour les cas graves. À ce moment-là, tu crois devenir folle », explique Florence Mirsaëb.
Ce sentiment est partagé par les huit femmes qui ont posé sous l’objectif de Marie Manecy. Une des photos, où l’une d’elles git sur le sol en criant, « fait référence à la mort, à l’envie de mourir », nous explique la photographe. Le sentiment de ne pas être entendue, d’être incomprise, d’être écrasée par un poids, ou encore de traîner une fatigue chronique, est illustré par des mises en scène touchantes, et « toujours dans le mouvement », rajoute Marie Manecy.
Puis, après ces premières photos, un grand panneau blanc symbolise une transition vers la lumière et l’authenticité. Sur ce panneau, trois femmes, dont Florence Mirsaëb, ont posé sur le thème des limites que l’on pose dans une telle situation pour se protéger.
Sororité et guérison#
Ce groupe, c’est aussi l’histoire d’une fusion qui a tout de suite opéré entre les participantes. Florence témoigne de ce lien : « Au départ, on ne se connaissait pas, mais on s’est toutes senties à notre place, sans avoir besoin de nommer la maladie. Ce projet, encadré par les compétences de Marie, nous a permis, à chacune, de faire naître une transition individuelle et collective. »
Très vite, la volonté de ces femmes a été de s’exprimer sur la réalité de cette maladie qu’elles vivent au quotidien.
« C’est encore tabou. Dans la société réunionnaise, on ne parle pas de ses règles, on va me dire tout de suite : “T’es chochotte, prends un cachet, ça ira mieux.” Ce sont des choses que j’ai souvent entendues », nous confie Florence Mirsaëb.
Dans la deuxième partie de l’exposition, les clichés transmettent un même message : la sororité libère, la rencontre unit et guérit. Une photo des huit femmes regroupées fait transparaître ce lien qui les a soudées lors de ce processus photographique, dont Florence parle comme d’une thérapie. Un mot que Marie Manecy ne souhaite pas utiliser pour décrire son travail, même si elle place en son cœur la notion de résilience.

« La différence avec ma démarche, c’est que s’il se passe quelque chose durant la séance photo, je ne l’ignore pas »#
Marie Manecy parle « d’art en santé », mais ne se range pas dans la case des « art-thérapeutes ».
« J’ai accepté l’idée que mon univers se suffisait à lui-même. Avec la thérapie, il y a cette idée d’objectifs, alors que je ne pars pas avec cette notion. Je pose un cadre très précis de travail, de bienveillance, d’échanges, mais devant l’objectif, ce que l’on fait, c’est construire des photographies à partir de l’expérience et du vécu. Aussi, la différence avec ma démarche, c’est que s’il se passe quelque chose durant la séance photo, je ne l’ignore pas. On en parle, on échange, on laisse parler nos émotions. »
Ce travail photographique suit aussi une méthode rigoureuse, car pour que les femmes laissent parler leur créativité, il faut poser un cadre qui s’y prête.
« Au départ, j’ai fait des interviews individuels où elles m’ont raconté leur lien avec la maladie, puis, ensemble, on a écouté tous les témoignages, anonymement. Avant et pendant chaque séance photo, on discute de leurs envies, puis après, de ce qu’on a envie de transmettre finalement. C’est un chemin pendant lequel les femmes changent d’avis, et ce mouvement fait partie d’un chemin de résilience. »
Depuis 2019, la photographe est habituée à créer ce cadre bienveillant pour prendre des clichés de personnes atteintes de maladies chroniques, post-traumatiques, de personnes ayant subi des agressions sexuelles, de l’inceste, ou encore des personnes atteintes d’obésité.
Ce samedi 29 février, la ville de Saint-Paul clôt ce mois dédié aux droits des femmes par une soirée à la Maison Serveaux, dernière occasion pour profiter de l’exposition.
Sarah Cortier