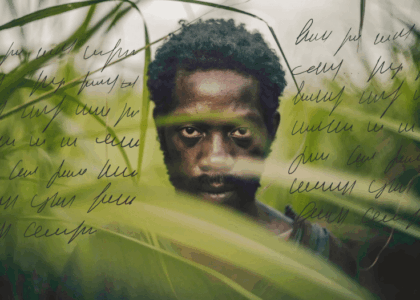Le Mois des Fiertés trouve son origine dans les émeutes de Stonewall, survenues en juin 1969 à New York. Menés en grande partie par des personnes trans et racisées, ces soulèvements avec des figures comme Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera ont marqué un tournant dans l’histoire des luttes LGBTQIA+. Depuis, chaque mois de juin est devenu un espace-temps mondial de visibilité, de mémoire et de revendication. Mais comment ces échos résonnent-ils dans des territoires comme La Réunion ? Quelle place y occupent les personnes queer dans l’espace public ? Et quelles sont les fiertés, mais aussi les blessures que l’on tait encore ?

Visibilité, oui. Mais à quelles conditions ?#
Si les mentalités évoluent et que la parole circule davantage, beaucoup de personnes LGBTQIA+ interrogées évoquent un sentiment de sécurité… partiel. “Je vis ma vie comme je l’entends », affirme une répondante de 45 ans, tandis qu’une autre nuance : « Je me sens libre avec mes ami·es, mais dans la rue, c’est une autre histoire ». Ce paradoxe revient souvent : la fierté se vit, mais surtout dans les cercles privés, familiaux ou militants.

Une personne le résume ainsi : “Même si aujourd’hui la pluralité de genre et de sexualité commence à être mieux comprise, il n’est pas toujours évident de se faire une place et d’être compris. Ce qui explique cette sécurité ressentie… mais restreinte.”
Des espaces qui comptent#
À La Réunion, certains lieux ont ouvert la voie : des boîtes de nuit comme Le Prince ou Le Loft, des associations comme OriZon ou Pilon. Ces espaces incarnent une visibilité queer créole, encore trop rare mais en expansion. Ils permettent aussi de tisser des liens communautaires, d’accueillir les plus jeunes, et de créer des passerelles intergénérationnelles.

L’importance de ces espaces est soulignée dans les réponses :
“Des soirées queer, des évènements qui permettent de créer du lien… On a besoin de lieux pour être ensemble, sans se cacher.”
Le Mois des Fiertés : un souffle, mais pas une fin#
Pour beaucoup de personnes interrogées, le Mois des Fiertés représente bien plus qu’une commémoration ou un slogan. C’est un interstice de liberté, une parenthèse durant laquelle leur existence est, enfin, prise en compte, célébrée et légitimée. Loin d’un simple événement festif, c’est un moment de réassurance identitaire, à la fois individuelle et collective.

“C’est un moment de mise en lumière, d’apprentissage, de visibilité. Cela me fait me sentir mieux de voir qu’on est autant”, écrit une jeune femme.
Mais cette parenthèse ne doit pas masquer les combats encore en cours. Certains regrettent le manque d’événements sur l’île, ou leur manque de diversité.
“J’aimerais que les marches soient plus festives, avec des prises de paroles, des chars, une vraie Pride quoi !”
“Il faudrait médiatiser davantage, et que ça ne reste pas entre personnes concernées.”
Plusieurs propositions concrètes émergent : projections de films LGBTQIA+, témoignages diffusés chaque jour du mois, transports pour faciliter l’accès aux marches, espaces de parole…
Ce qui frappe à travers les réponses, c’est l’attente de visibilité plus soutenue et plus variée. Beaucoup évoquent le manque de communication autour des événements liés à la Pride : un déficit de relais dans les médias locaux, une diffusion jugée trop tardive, et une portée souvent limitée aux personnes déjà engagées ou sensibilisées.
“On devrait mieux communiquer sur les événements, plus longtemps à l’avance et avec plus de médias.”
“À part les personnes concernées, je ne connais pas beaucoup de monde qui connaît le Mois des Fiertés.”
Ce manque de relais empêche souvent la communauté queer réunionnaise d’être pleinement incluse dans le récit collectif de l’île. À cela s’ajoute le manque de représentation dans l’espace public : peu de drapeaux, peu d’entreprises impliquées, peu de signes visibles de cette appartenance partagée.
“Dans des villes d’Écosse que j’ai visité récemment, il y avait des drapeaux partout, même dans les magasins ou à la fac. Ce genre de visibilité crée un sentiment d’unité.”
Obstacles et résistances#
À travers les témoignages, une réalité revient avec insistance : être queer à La Réunion, c’est souvent devoir composer avec des normes profondément ancrées. Les freins évoqués sont culturels, religieux, familiaux et ils s’expriment parfois de manière insidieuse, parfois avec une violence frontale. Derrière les sourires et le “vivre-ensemble” souvent mis en avant, certain·es racontent un quotidien où l’incompréhension, le rejet ou la solitude pèsent lourd.
“Les Réunionnais·es ont peur de ce qu’ils ne comprennent pas. La bienveillance s’arrête là où les repères culturels sont bousculés.”

“On m’a dit : ‘Tu ne peux pas être pédé et créole.’ Comme si l’identité queer était incompatible avec notre culture.”
Une violence parfois symbolique, parfois directe. Certains témoignages parlent de discriminations médicales, de harcèlement scolaire, de rejet parental. Mais aussi de résistance, de fierté assumée, et de reconstruction.
Entre fierté et persistance#
Vivre sa fierté à La Réunion, c’est composer avec des avancées précieuses et des résistances persistantes. C’est évoluer dans une société en transition, où la reconnaissance se gagne souvent à petits pas, à l’échelle de ses ami·es, de sa famille, de quelques lieux encore trop rares. Mais c’est aussi affirmer haut et fort une identité queer réunionnaise, riche, plurielle, résiliente. À travers les témoignages recueillis, se dessine une communauté vivante, parfois fragmentée, mais profondément déterminée à exister. Et si les défis restent nombreux, une chose est sûre : la parole est là, plus forte, plus libre, et ne demande qu’à circuler.
“La route lé encore longue, mais tien bo larg pa.”
“Je suis fière de dire que je suis Créole, Réunionnaise et Queer. Nous existons, et nous continuerons de lutter.”
Tous les témoignages recueillis pour cet article sont anonymes. Un choix qui, à lui seul, rappelle le chemin qu’il reste à parcourir pour que chacune et chacun puisse vivre pleinement sa fierté, à visage découvert, dans une société réunionnaise encore en mutation.
“Aucune libération pour les uns sans libération pour tous.” Marsha P. Johnson, militante trans noire américaine et figure emblématique des émeutes de Stonewall
Florian Mazona
Contribution bénévole