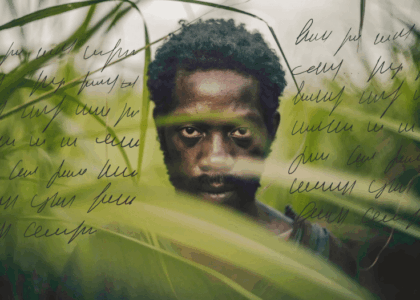Pendant une semaine, les spécialistes de la lutte contre le risque requin du monde entier se sont retrouvés à La Réunion pour un colloque destiné à échanger les expériences et trouver des solutions.
« C’est la première fois qu’un colloque est consacré aux stratégies de lutte contre le risque requin, c’est une première mondiale avec la présence de tous les pays impactés par ce problème », souligne Willy Cail, directeur du CSR (Centre sécurité requin), organisateur de l’événement. Pendant cinq jours, entre les 24 et 28 mars, les spécialistes du monde entier sont venus expliquer les méthodes qu’ils emploient chez eux et échanger leurs expériences. Et comprendre les différences. « Pourquoi, à Hawaï ou en Calédonie, ce sont les tigres qui sont responsables des attaques quand ici ce sont les bouledogues ? »
Ce colloque arrive quand l’Etat, à La Réunion, envisage sérieusement de lever les interdictions de surf et de baignade. Déjà, « la baignade est autorisée depuis 2023 sur les platiers arrières des récifs, même s’ils ne sont pas fermés comme ceux appelés à tort lagons », évoque Willy Cail. « Et, depuis 2025, la nage avec palme masque et tuba est autorisée », poursuit-il. Surtout, le directeur du CSR assure qu’il « travaille très fort, le préfet a été clair, à l’autorisation du surf en dehors des zones surveillées ».
«Problèmes psychiatriques»#
« Mais il ne faut pas être inconscient », souligne Willy Cail. Cette levée d’interdiction nécessitera le port de systèmes répulsifs électroacoustiques. « Ni surfer n’importe où et n’importe quand. Surfer comme on l’a vu près de la Grande ravine à Trois-Bassins après le cyclone, dans la boue, c’est suicidaire et ça nuit à notre action. Et défendre ces comportements comme le fait Jean-François Nativel, conseiller municipal et départemental, c’est avoir des problèmes psychiatriques. »
Depuis six ans, aucune attaque de requin n’a été à déplorer à La Réunion. Jamais dans l’histoire de l’île ce n’était arrivé. « C’est grâce à notre travail », prétend Willy Cail. Peut-être, mais aucune étude, aucune preuve scientifique ne l’accrédite. « En 2017, nous avons pêché 52 requins bouledogues ; ce n’est plus que 4 par an aujourd’hui », justifie-t-il. Pour autant, là aussi la philosophie évolue et les idées venues d’ailleurs séduisent. Y compris de celles proposées par Didier Dérand, le président de l’association Vagues, comme le relâcher après capture de requins tigres sur un modèle brésilien. « La pêche, ça suffit ; il faut marquer et comprendre », estime Willy Cail, qui évalue le coût des prélèvements de 544 requins entre 2018 et 2024 à 100 millions d’euros. Une vingtaine de tigres juvéniles de moins de 2,5 m seront équipés de balises et de GPS qui permettront de les détecter en temps réel et de faire avancer la connaissance.
A La Réunion, on pêche, mais la nuit. « Ailleurs, c’est en journée. Ils jouent sur l’efficacité, la protection, alors qu’ici nous réduisons les risques. Pourtant, il est certain que l’appât ne fait pas venir les requins du large », remarque le directeur du CSR.
A l’occasion de cette journée de clôture, une dernière conférence ouverte au public, sur les enjeux et outils de gestion du risque requin, s’est tenue à l’Hôtel du Récif, à Saint-Gilles-les Bains.
Parmi les intervenants invités lors de cette journée, Erwann Lagabrielle, géographe, maître de conférence à l’université de la Réunion, et chercheur associé au Centre Sécurité Requin, a présenté une synthèse du travail réalisé avec ses équipes. Erwann Lababrielle est spécialisé sur l’analyse des politiques d’aménagement, l’évaluation des services éco-systémiques et les outils de gouvernance participatives, notamment appliquées aux politiques marines et côtières durables. Dans ce cadre et avec son associé Olivier Dupéré, spécialiste du droit de la mer et des risques naturels, ils ont présenté leur travail intitulé « Construction juridique d’une échelle du risque requin et exploration de scénarios de gouvernance adaptatifs avec les usagers de la mer. Cas de La Réunion. »
«Allégement des interdictions de baignade»#
Plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour analyser le risque, Erwann Gabrielle a précisément travaillé sur l’évaluation du risque requin, et de ses principaux critères, par les usagers de la mer. Les résultats présentés montrent que les usagers de la mer évaluent le risque selon plusieurs critères gradués de manière cohérente. Parmi eux, les attaques recensées, les observations d’individus de requins, les facteurs météorologiques ( pluie, eau trouble, etc.), ou encore les politiques publiques mises en place. Les études montrent donc une cohérence dans l’analyse du risque, en parallèle d’une certaine acculturation à ce risque, un contexte qui pourrait donc faire évoluer la législation vers un allégement des interdiction de baignade explique Erwann Lagabrielle.
« A propos de la construction juridique d’une échelle du risque requin à la Réunion, il y a trois enjeux en réalité: la sécurité, la liberté et l’environnement. Ces trois éléments doivent être pris en compte ensemble, dans la construction de toute politique publique. Elle se construit sur des preuves, avec transparence, durabilité et cohérence. Les politiques publiques doivent être construites avec humilité, et prenant en compte tout le travail scientifique qui a été fait », dit-il.
Et pour la juridiction quant au risque requin, Erwann Lagabrielle indique que, « en 2013, un arrêté préfectoral a été voté par le Conseil d’Etat, de façon très exceptionnelle, pour interdire la baignade dans la zone des 300 mètres, excepté sur un “platier”, ou derrière un filet de protection. On a considéré alors qu’aucun usager n’était en capacité d’envisager de manière objective le risque, donc on a préféré interdire. Depuis, on reconduit cet arrêté.
« Aujourd’hui, la stratégie est de soulager petit à petit les restrictions de baignade, pour éviter aussi les contestations. C’est pour cela, que l’on a autorisé la baignade avec palmes masque tuba dans la zone des 300 mètres.
« Depuis six ans maintenant, aucune attaque de requin n’a été relevée. La position des autorités publiques relève de la prudence avant tout », explique Erwann Lagabrielle. Pour autant, tout dépend de comment on analyse le risque, sur quelle échelle de temps? Si l’on prend une échelle de cinq ans, alors le risque est faible, si l’on prend une échelle de temps à 10 ans, c’est différent.
Une étude sur l’efficacité de la pêche préventive#
Enfin, si aucune preuve scientifique ne permet aujourd’hui d’établir les raisons expliquant l’absence d’attaques depuis 2019, Erwann Lagabrielle confie que la relation statistique entre la pêche préventive et l’absence d’attaque fait l’objet d’études scientifiques, dont les résultats n’ont pas encore été dévoilés.
La collègue d’Erwann Lagabrielle, Virginie Cordier, a pour sa part rappelé les dispositifs (Vigie Requins et Waterpatrol, tous deux expérimentaux) de surveillance des pratiquants de surf mis en place à La Réunion et comment ils pouvaient être le plus efficaces. Elle a notamment expliqué pourquoi la surveillance par drones ne fonctionnait pas chez nous. « On peut distinguer les requins, et reconnaitre l’espèce par IA, quand le sable est blanc. Chez nous le fond est noir », souligne la scientifique de l’université.
D’autres intervenants ont expliqué, par exemple, comment on marque les requins blancs en Californie. « Dans cet état américain, la mer est une industrie qui représente des milliards de dollars. Trois millions de surfeurs, vingt millions de personnes qui vivent à moins de 40 km de l’océan, 10 000 baigneurs quotidiens », souligne Sarah Waries, directrice générale de « Shark Spotter », un programme sud-africain de recherche et de surveillance des requins à l’échelle locale. « Quand un requin est repéré, il faut évacuer la plage, ce qui représente un coût économique de 150 000 à 250 000 dollars pour la journée perdue », poursuit-elle. Il est donc primordial de limiter ces alertes en affinant au plus près l’observation du comportement des requins. On doit savoir avant d’alerter s’ils sont en train de dormir, de chasser ou juste de passage. Toutes choses étudiées grâce à des marquages et des suivis d’individus en temps réel.
Un autre enjeu de taille, et la mère de toutes les bataille, est l’information et la responsabilisation des usagers de la mer. C’est ce que disait Willy Cail, c’est aussi ce que rappelait Sarah Waries: « Le gouvernement ne peut pas garantir votre sécurité tout le temps. La mer, c’est comme marcher dans la rue, il peut arriver un accident. Il faut surtout comprendre que l’océan est un espace sauvage, être conscient de ce qui nous entoure. »
Sarah Cortier et Philippe Nanpon