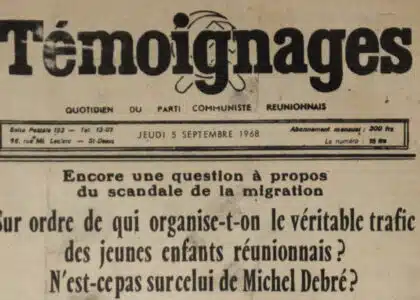Souvent réduit à ses clichés de « quartier chaud », Bras-Fusil, à Saint-Benoît, cache une réalité bien plus nuancée. Entre initiatives solidaires, engagements associatifs et liens de voisinage, les habitants construisent au quotidien un vivre-ensemble résilient. Un regard de l’intérieur s’impose.
Bras-Fusil : un quartier mal compris#
À la périphérie de Saint-Benoît, le quartier de Bras-Fusil porte sur ses épaules le poids des mots qu’on lui colle. « Zone sensible », « quartier chaud », « territoire de non-droit » : autant d’étiquettes qui, depuis des mois, s’accrochent aux discours officiels comme aux posts sur les réseaux sociaux.
Début 2025, le plan anti-bandes a mis Bras-Fusil dans la ligne de mire. Sur le compte Instagram de la préfecture de La Réunion, une vidéo en date du 8 février montre des agents de la BAC et l’escadron de gendarmerie mobile en opération dans les quartiers de l’Est. Le message est clair : il faut restaurer l’ordre.
Mais derrière l’image d’un quartier à contrôler, il y a une réalité que beaucoup préfèrent ignorer — celle d’un quartier vivant, porté à bout de bras par celles et ceux qui y vivent, y travaillent, y inventent tous les jours des formes de solidarité.
Solidarité et initiatives locales#
« Les médias devraient venir voir le cross du collège du quartier, pas seulement la poubelle qui brûle », glisse Cyril Poignard, salarié de l’association K-pab6t, qui organise des ateliers de bricolage, de cuisine ou des séjours de vacances pour les enfants. « Après le cyclone Garance, la priorité a été d’accompagner les habitants dans leur démarches pour des réparations urgentes. » Mais très vite, les actions se sont élargies. « Ce qu’on propose, c’est du lien. Et quand il y a de la confiance, on devient ressource pour plein de choses. »
Dans la salle d’activités de l’association Nouroulidjnati Madaniya, les mamans préparent des goula-goula, entre rires et confidences. Fatima, présidente de l’association, est arrivée de Mayotte il y a dix ans. Elle vit ici depuis neuf. « On n’a aucun souci, on est bien », lance-t-elle en riant. « Les enfants jouent entre eux, ils s’apprécient. Des fois, on est quelques jours sans eau ou sans électricité, mais sinon, y’a pas eu de gros dégâts. » Puis elle ajoute : « Ça reste un quartier comme un autre. Y’a des jeunes qui jouent, d’autres se battent, d’autres s’aiment. »
Ce regard de l’intérieur, contrasté, réaliste et chaleureux, revient aussi dans les paroles de Jean-Claude, habitant de toujours. Il se souvient d’un quartier agricole, ceinturé de cannes et de vergers, avant les grands projets d’urbanisation dans les années 80. Il connaît les tensions, les incompréhensions, mais refuse les amalgames. « La délinquance existe, bien sûr. Mais Bras-Fusil était plus dangereux bien avant l’arrivée des Mahorais. L’île est pas raciste, mais elle est en colère. » Ce qu’il demande, ce sont des moments de rencontre, de partage. « Il faut qu’on arrête de mettre de l’huile sur le feu. »
Éducateurs de rue : un travail de longue haleine#
Sur le terrain, les éducateurs de rue comme Mathilde, Boubacar ou Gaëtan, engagés avec la Scopad, savent à quel point le lien humain est fragile. Leur mission ? Aller à la rencontre des jeunes, souvent en rupture avec l’école, la famille ou les institutions. « Ils sont plus à l’aise quand on vient à eux. On passe par leur quotidien », raconte Mathilde. Le travail est de fond : cohésion de quartier, insertion, réduction des risques, soutien à la parentalité. Mais le temps manque. « Avec des financements d’un an, on casse des dynamiques qui demandent de la durée. »
La vie du quartier ne se résume ni à ses failles ni à ses stigmates. Elle est faite d’initiatives locales, de bricolage solidaire, de repas partagés et de regards bienveillants. Mais la tension est palpable, surtout après les catastrophes naturelles. « Après le cyclone, plusieurs animaux morts ont été retrouvés, et chaque communauté s’est accusée », raconte un habitant. Il conclut, amer : « On est tous l’étranger de quelqu’un. »
Ce climat, le photographe Olivier Lardeux l’a documenté pendant près de deux ans dans son projet Il était une fois dans l’Est. Loin des images anxiogènes, ses photos racontent le quotidien, les silences, les rires et les gestes d’entraide. Une réalité souvent absente des reportages à sensation. Après deux années à travailler sur le quartier, il résume son travail à travers ces mots : « Là où les autres voient des difficultés, des problèmes, il y a des histoires d’amour, des solidarités qui tissent un maillage humain fort et essentiel. »
Repenser la politique des quartiers populaires#
Pour un autre habitant, le problème n’est pas celui de communautés mais plutôt un problème de politique urbaine. « En 1986, on a décidé de transformer radicalement le quartier de Bras-Fusil en adoptant les mêmes politiques urbaines que dans les banlieues hexagonales. On a réuni à l’extérieur des villes des populations sans aucune mixité sociale. »
Lorsque les premiers projets d’urbanisation sont mis en oeuvre autour de Saint-Benoît au début des années 70, on passe donc d’un habitat majoritairement individuel composé de cases en tôles à de l’habitat collectif où vont se retrouver des populations appartenant majoritairement aux classes populaires. En 2009, un rapport qualitatif sur le quartier de Bras-Fusil, pointe d’ailleurs de nombreux dysfonctionnements avec « des ensembles collectifs qui commencent à se dégrader », « peu de services publics » et « une population économiquement fragilisée ».
Au-delà des efforts individuels, c’est donc toute une structure de quartier qu’il faut renforcer. Un centre social, porté par la Ville de Saint-Benoît et appuyé par le CFPD, devrait ouvrir d’ici la fin de l’année. Aurore Richard, cheffe de projet, y voit une chance de poser les bases d’une action durable, ancrée et partagée. Un lieu ressource pour apaiser les tensions, rassembler les forces et faire vivre autrement ce « vivre-ensemble » qu’on brandit souvent sans le construire.
Peut-être faut-il aussi repenser notre manière de faire de la sécurité. La création d’une Brigade Territoriale Mobile (BTM) s’inscrit dans cette volonté de renouer avec une police de proximité, moins dans la confrontation, plus dans la présence. Un virage encore timide, mais attendu par ceux qui connaissent la valeur d’une écoute.
À Bras-Fusil, la vie est là. Pas toujours facile, mais résolument collective. Elle mérite mieux qu’un résumé en quelques hashtags ou images chocs. Elle mérite qu’on prenne le temps. Qu’on écoute. Et qu’on raconte autrement.
Olivier Ceccaldi (texte & photos)