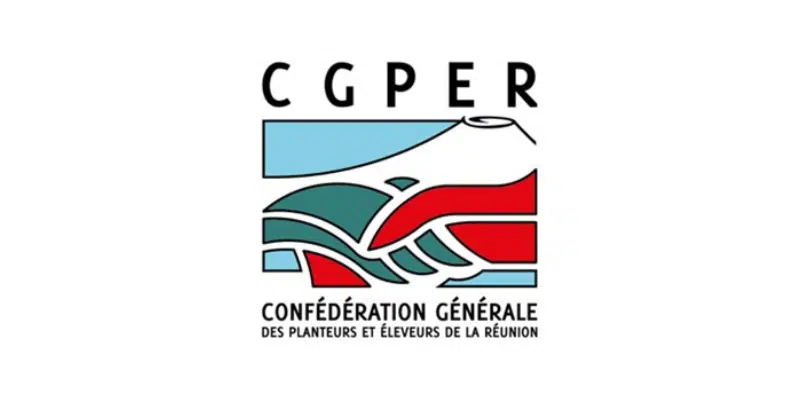Le 12 mai 2025
Dans le cadre de cette tribune libre, la CGPER propose de faire un point sur la préparation des états généraux de la canne prévus à la fin juin prochain, qui seront portés par les collectivités locales, l’État et la chambre d’agriculture. Pour mener cette réflexion, il est indispensable, au préalable, de réaliser un état des lieux le plus exhaustif possible de la filière avec une analyse approfondie de tous les maillons pour envisager des propositions concrètes afin de relancer la filière à travers quelques éléments forts autour de 4 points importants pour susciter les débats.
1. La gestion du cyclone GARANCE :
Depuis de très nombreuses années, La Réunion a su gérer les problèmes climatiques tant bien que mal par une anticipation rapide des planteurs sur la fertilisation et la main-d’œuvre nécessaire pour relancer la production avec l’aide du Conseil Départemental sur les aides d’urgence. La mise en œuvre du fonds de secours des Outre-mer est encadrée par des dispositifs beaucoup trop longs (CDE, rapport de la préfecture transmis au ministère des Outre-mer et ministère de l’Agriculture, instruction du dossier à Paris sur les modalités d’éligibilité des agriculteurs et notification au préfet de région pour la mise en œuvre des aides — durée de 10 à plus de 12 mois en général).
Il faut faire évoluer les dispositifs actuels pour être plus opérationnels. Pour cela, il convient de réviser les modalités d’indemnisation des calamités agricoles sur le fonds de secours, sur les deux critères majeurs (justifier de pertes représentant au moins 13 % du chiffre d’affaires global et 25 % de la production concernée), qui ne sont plus adaptés à notre agriculture et à notre contexte d’insularité.
On propose de mettre en place à La Réunion un fonds de secours local, qui serait alimenté sur la base d’un apport financier de tous les acteurs de la filière canne (CPCS, TEREOS, Albioma, les distilleries), du Conseil Départemental, du Conseil Régional et du FEADER (en moyenne 3,5 millions €/an d’indemnisation sur les 10 dernières années). On ne peut plus attendre la solidarité nationale uniquement, car les procédures d’intervention sont beaucoup trop longues pour relancer l’agriculture après les problèmes climatiques ou par l’assurance récolte en cours de négociation.
L’objectif, c’est d’être plus performant et réactif avec un dispositif d’indemnisation local qui serait géré par le CPCS, sous le contrôle des commissaires du gouvernement (DAAF et DRFIF), pour pouvoir mieux indemniser les planteurs en complémentarité avec le FSOM après le passage du cyclone ou de la sécheresse. Car ce n’est pas normal que les planteurs doivent attendre plus d’une année avant d’être indemnisés.
Exemple : pour le cyclone BELAL de mi-janvier 2024, les planteurs ont reçu les indemnisations une semaine avant l’arrivée du Président de la République en mai 2025. Cela entraîne des répercussions importantes sur la trésorerie et des baisses de production des exploitations agricoles.
2. Les problèmes actuels de la filière canne :
Les difficultés rencontrées dans la filière canne ne sont pas seulement dues aux cyclones ou aux sécheresses successifs comme tout le monde s’accorde à le dire pour ne pas se pencher sur les véritables raisons. Oui, on a un vrai problème structurel dans la filière, et depuis plusieurs années les vraies questions ne sont pas abordées, et au fur et à mesure, elle ne dégage plus suffisamment de revenu pour motiver les agriculteurs, faire vivre les familles et investir, et ce sont toujours les planteurs qui paient la perte de compétitivité.
En plus des problématiques sur les difficultés à trouver de la main-d’œuvre et la disparition progressive des molécules contre les mauvaises herbes, cela oblige les exploitations agricoles à investir dans la mécanisation, ce qui entraîne un endettement important, voire la disparition des exploitations agricoles les plus vulnérables car elles ne deviennent plus rentables. Avec la disparition des sociétés de travaux (REDETAR, SICA …) ces dernières années, les agriculteurs sont livrés à eux-mêmes pour effectuer les travaux d’amélioration foncière, de plantation, etc. On constate un phénomène de suréquipement dans les exploitations agricoles.
Un autre danger qui menace l’agriculture, c’est le vieillissement de la population de planteurs, qui peine à se renouveler par des installations de jeunes agriculteurs. Le constat, c’est que de nombreuses exploitations sont en sous-production, voire à l’abandon, des terres devenant des friches. Un travail important est à mettre en place sur la problématique des transmissions des exploitations pour les agriculteurs qui atteignent l’âge de la retraite et qui envisagent de cesser leur activité professionnelle.
Il convient de mener une réflexion sur la mise en place de la préretraite, comme ce fut le cas en 1998 à La Réunion, sur une expérimentation avec le Conseil Départemental et les services de l’État.
En effet, nous proposons de revoir cette décision législative sur la retraite agricole, qui devra être portée par nos parlementaires, car cette mesure n’est pas adaptée à nos territoires ultramarins. Nous proposons de travailler sur un dispositif qui encourage le départ en préretraite des agriculteurs à partir de 60 ans, sous condition d’une installation d’un agriculteur dans le cadre de la transmission des exploitations agricoles.
Ce dispositif avait été appliqué à La Réunion entre 1998 et 2012, et le dispositif avait été évalué favorablement en 2004 et 2005.
En 7 ans d’expérimentation, les résultats étaient les suivants :
- La surface totale libérée a été de plus de 2 000 hectares de surface agricole utile pour environ 500 départs en préretraite.
- Les surfaces libérées ont permis d’installer 103 jeunes agriculteurs et d’agrandir 183 exploitations, passées de 5,5 ha à 8,4 ha en moyenne.
- Une installation aidée de jeune agriculteur sur quatre durant la période est issue d’un départ en préretraite.
- Il a mis en place un partenariat efficace entre la chambre d’agriculture, le CNASEA, la DAAF, la SAFER et la CGSS.
- Il a été constaté une forte attractivité du dispositif. Sur cette opération, le CNASEA avait reçu plus de 700 demandes d’installation.
D’autre part, la DAAF, à travers les centres de formation, doit impérativement lancer un plan de communication pour revaloriser les installations agricoles et surtout l’emploi des salariés agricoles.
De plus, il est impératif, à l’aube du début de la campagne sucrière, de prendre des décisions urgentes pour relancer la production de canne dès cette année, par une aide de 1 850 €/ha, pour redonner de la trésorerie aux exploitations. Sinon, on aura une campagne sucrière médiocre en 2026.
Un autre point important sur la baisse de production, c’est le foncier agricole. De 2010 à 2020, la filière a perdu plus de 4 000 hectares de SAU et de 2021 à 2024, on aurait perdu plus de 2 000 hectares de SAU, alors même que le rendement moyen est passé durant la même période de 72,5 t/ha à 62 t/ha (sur les dix dernières années, on aurait perdu plus de 10 t/ha malgré de nombreux financements dans la filière). On assiste à une dégradation de la compétitivité et une diminution des surfaces en canne, qui s’accélère au fil des années et entraîne globalement une baisse logique du tonnage global sur les 5 bassins de production.
3. Comment redonner de la compétitivité pour pérenniser la filière canne :
Avec un tonnage en chute libre depuis ces dernières années (1987 : 1,860 million de tonnes et 2024 : 1,137 million de tonnes), avec une perte de production de plus de 700 000 tonnes (équivalent moyen de broyage d’une usine sucrière), un rendement par hectare en recul de plus de 10 tonnes depuis 10 ans, malgré la présence sur notre territoire d’un organisme de recherche variétale, des moyens d’encadrement technique importants avec la chambre d’agriculture, TEREOS, Ercane, CIRAD et le CTICS, les résultats techniques se dégradent d’année en année sans que personne ne s’inquiète de la descente aux enfers de la filière. Il serait intéressant que les acteurs de la filière s’expriment là-dessus pour connaître leur analyse et comprendre un tel silence de leur part.
Ce n’est pas la faute aux planteurs mais aux organismes périphériques qui n’ont pas de projet de filière cohérent depuis ces dix dernières années, et c’est sans cesse la course chaque année à la recherche de financements pour augmenter encore plus le nombre d’encadrants dans les structures. Cependant, une chose est sûre : la production de canne est constamment en baisse, et la compétitivité de la filière se dégrade très fortement.
Alors, on doit impérativement analyser ce point, car ce n’est pas normal de constater une telle dégradation de la production de canne avec tous les moyens financiers mis dans la filière. Une vraie réflexion doit être engagée sur la performance de l’encadrement technique dans les différents organismes, car on constate une dispersion des moyens humains avec un manque de cohérence sur les objectifs de développement qui ne sont pas partagés avec les planteurs. Un seul organisme doit être porteur de l’encadrement technique pour recadrer les incohérences techniques et flécher les actions avec les producteurs, qui ont beaucoup de mal à s’en sortir techniquement, ce qui se traduit inexorablement par des résultats technico-économiques catastrophiques, et qui encourage les planteurs à abandonner la production.
Le plus surprenant, c’est que lorsqu’on analyse les données des producteurs sur les livraisons à l’usine, on constate qu’en 2024 (source CTICS) :
- 447 planteurs (76 923 t) ont un rendement de moins de 40 t/ha
- 586 planteurs (234 654 t) ont un rendement entre 40 et 60 t/ha
- 595 planteurs (420 480 t) ont un rendement entre 60 et 80 t/ha
- 375 planteurs (272 218 t) ont un rendement entre 80 et 100 t/ha
- 160 planteurs (123 000 t) font plus de 100 t/ha
- La tranche d’âge de 50 ans et plus a le plus grand nombre de participants avec 98 femmes et 627 hommes, et 605 planteurs ont plus de 60 ans.
Face à ce constat alarmant, aucune réaction des services de l’État, du Conseil Départemental, de la chambre d’agriculture, de l’industriel et des autres organismes de développement. La production est en forte baisse, et chacun s’accorde à dire que c’est la faute au cyclone et à la sécheresse, sans s’alarmer ni déclencher des réunions d’urgence pour connaître les vraies causes.
Contribution de la CGPER :
L’objectif affiché, c’est de redonner du revenu aux exploitations cannières à travers la mise en place d’un nouveau projet de développement, en tenant compte des éléments nouveaux, à savoir le changement climatique, les bouleversements géopolitiques dans le monde, les problématiques de l’environnement sur la production agricole… sur :
- L’amélioration du rendement par hectare, par une optimisation des moyens présents sur l’encadrement technique porté par une seule structure, sur les variétés adaptées aux bassins de production, de l’irrigation et de la recherche d’optimisation sur le travail (MO et mécanisation)
- Des actions concrètes mesurables sur la transmission des exploitations des 1 000 planteurs (moins de 60 t/ha) qui seront amenés à prendre leur retraite sous peu. Il convient de faire un suivi individuel pour mesurer la temporalité et les projets de ces exploitations agricoles pour les années à venir (groupe progrès)
- Fixer des orientations claires et quantifiables sur la nouvelle stratégie de développement de la filière, en impliquant les syndicats agricoles dans la réflexion
- La renégociation de la formule de paiement de la canne à sucre avec l’ensemble des acteurs de la filière. La richesse de référence 13,8 (moyenne décennale) encore en vigueur aujourd’hui a été fixée en 1978, alors que la moyenne décennale 2014-2024 est de 13,35 (source CTICS)
- Depuis, de nombreux indicateurs ont évolué favorablement pour les usiniers, et il convient de les corriger, comme l’écart technique, la performance des usines, d’autant plus que les usiniers bénéficient chaque année des aides publiques pour améliorer la performance des usines. Et est-ce que ce sont les planteurs qui doivent continuer à payer le coût de transformation de la canne dans les usines comme actuellement, les nouvelles variétés, les techniques de coupe… Les deux usines du groupe TEREOS sont très performantes actuellement, reconnues par les services de l’État et les meilleurs spécialistes mondiaux du sucre. Un travail d’évaluation doit être mis en place pour apporter de la transparence sur ce sujet
- Le nouveau projet de la filière canne est nécessaire et indispensable pour l’avenir. Il devra être basé sur la polyculture-élevage avec de la diversification agricole, l’agritourisme et la transformation des produits pour les petites exploitations agricoles si on veut sauver notre patrimoine agricole, riche en diversité de produits pays. Les produits de diversification pourraient soutenir la trésorerie d’exploitation pendant les périodes particulièrement difficiles
- Et enfin, quelle est la place de la canne dans l’agriculture réunionnaise ? On devra aussi commencer à réfléchir sur le projet agricole pour la prochaine programmation du PSN (2028-2034), en cohérence avec les autres filières de production.
4. Le financement de la filière canne :
En tant que département français depuis 1946, La Réunion fait partie de l’Union européenne, et à ce titre, elle fait partie des régions ultrapériphériques. Du fait de son statut, elle bénéficie de mesures spécifiques qui adaptent le droit européen en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières de ces régions, notamment de l’insularité et de l’éloignement du territoire européen. Ces notions sont reconnues dans la déclaration annexée au traité de Maastricht de 1992 et consacrées en 1997 par l’article 299-2 du traité d’Amsterdam, puis reprises dans l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette reconnaissance ouvre des droits sur l’agriculture, aux aides d’État et des conditions d’accès aux fonds structurels européens.
C’est sur la base de cette reconnaissance que La Réunion bénéficie des aides diverses sur le fonctionnement et sur les investissements de son agriculture.
Dans le cadre du Programme Stratégique National (PSN), l’Union européenne, avec le Conseil Départemental, finance l’agriculture réunionnaise depuis plusieurs dizaines d’années sur le FEADER (développement rural), des aides d’État diverses (CIOM et ODEADOM…), de l’Europe sur le POSEI à travers les interprofessions, et du Conseil Départemental sur les fonds hors programme…
C’est ainsi que l’agriculture réunionnaise bénéficie chaque année d’un peu plus de 270 millions d’euros pour financer le développement rural à travers les différents dispositifs financiers, dont un peu plus de 52 %, soit 100 millions, consacrés à la filière canne, 20 % aux filières végétales hors canne et 7 % aux filières animales. Ce n’est pas un problème d’argent pour le financement de notre agriculture, mais une juste répartition des enveloppes de façon plus équitable et plus transparente dans les filières agricoles.
En 2018, la production de canne a été de 1 421 kt pour une production de sucre de 145 000 t et pour 85 millions d’euros affectés à la filière.
En 2022, la production de canne a été de 1 300 kt pour une production de sucre de 130 000 t et pour 100 millions d’euros affectés à la filière.
Doit-on parler du principe de la machine à laver comme en Martinique, sur les techniques de répartition et de la consommation des aides publiques entre les planteurs de banane et les industriels ?
On demande une plus grande transparence sur le montant total des aides affectées à la filière et sur sa répartition avec les acteurs, notamment les planteurs.
Comment mieux répartir les financements de la filière sur la base d’un nouveau projet ?
Si nous voulons véritablement relancer la production de canne à La Réunion, il faudra accepter de casser les codes, revoir notre disque dur et reformater nos logiciels.
Les planteurs n’accepteront plus que la richesse produite dans les autres entreprises dépendantes de la canne à sucre ne soit pas partagée de façon équitable. Il faudra bien envisager d’intégrer cette notion de partage dans une justice sociale et économique dans notre raisonnement à partir d’aujourd’hui.
Plus de filière canne à La Réunion, il n’y aura plus d’énergie produite avec de la bagasse, et une remise en cause du PPE du Conseil Régional et de notre souveraineté énergétique, plus de mélasse pour fabriquer les rhums, plus de jus pour fabriquer du sucre (premier produit d’exportation), plus de bagasse pour les élevages de ruminants, et plus de surfaces en canne pour les plans d’épandage, avec une grande remise en cause sur les productions animales.
Les planteurs, qui sont au début de la chaîne de production, veulent être mieux considérés et mieux rémunérés en tant que producteurs de matières premières. Les industriels avancent souvent seuls, les délaissant dans les décisions stratégiques.
Pour bâtir un avenir durable, il est impératif de mieux partager les efforts et les bénéfices entre tous les acteurs de la filière. Les planteurs, véritables gardiens de cette culture, doivent être mieux valorisés et soutenus dans leur transition vers des pratiques plus modernes et plus rentables.
Le président de la CGPER
Jean-Michel MOUTAMA