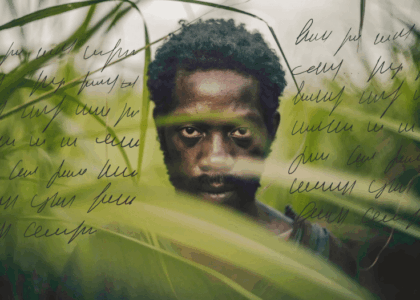Depuis maintenant deux semaines, La Réunion ne se situe plus en phase épidémique de propagation du virus du chikungunya. L’heure est au bilan : intensité du virus, impact sur la population, formes longues, vaccin… l’ARS et le CHU Réunion ont répondu aux questions de Parallèle Sud.
Depuis le 24 juin dernier, le dispositif Orsec de lutte contre les arboviroses est passé au niveau 2, sous décision du directeur général de l’ARS Réunion et du préfet Patrice Latron. Par cette décision, est signifiée une « circulation virale autochtone modérée » et donc la fin de la situation épidémique. Qui dit fin d’épidémie, dit réalisation des premiers bilans, même s’ils sont particulièrement durs à chiffrer avec ce virus.
En ce qui concerne les chiffres, l’ARS a confirmé 54 233 cas depuis le début de l’année, avec 577 hospitalisations et 28 décès. Pourtant, l’estimation du nombre de cas réels s’approche plutôt des 200 000 personnes, affirme Xavier Deparis, directeur de la veille et de la sécurité sanitaires, santé et milieux de vie à l’ARS La Réunion. « Tous les gens malades n’ont pas consulté un médecin et n’ont pas tous fait de prise de sang, ce qui rend difficile l’estimation précise du nombre de cas de chikungunya. » En comparaison avec la crise du Covid, les tests PCR et prises de sang quasi systématiquement réalisés ont permis d’obtenir des chiffres plus précis que pour cette épidémie.

Par ailleurs, il est parfois difficile d’imputer des décès à la seule contraction du chikungunya chez des patients déjà fragiles. C’est ce qu’explique le docteur Philippe Ocquidant, chef de service en neuro-réanimation au CHU Sud, directeur médical de crise et vice-président de la CME du CHU.
« Les deux populations à haut risque étaient les personnes âgées et les nouveau-nés, qui peuvent subir des transmissions materno-fœtales du virus. Dans le premier cas, on a eu des personnes âgées qui ont décompensé des pathologies déjà préexistantes en contractant le chikungunya. Donc c’est délicat d’imputer un décès seulement au chikungunya. »
En termes d’intensité des symptômes, les deux professionnels sont raccords : le virus de 2025 était moins symptomatique que celui de 2006. Les deux sont à distinguer, car cette année, il venait d’Afrique, tandis qu’en 2006, il était asiatique.
Pour ce qui est des formes longues du virus, là encore, il est difficile de savoir combien de personnes sont touchées. Xavier Deparis mentionne cependant une constatation :
« A priori, ce qui a été observé en 2006, et de nouveau en 2025, c’est que les femmes seraient plus touchées par les formes longues du virus, mais cela n’a pas pu être confirmé. On n’a pas encore assez d’éléments pour tirer des conclusions et chaque personne réagit différemment à la douleur. »
Une gestion maîtrisée de l’épidémie au CHU #
Dans les couloirs du CHU, la crise a été moins complexe à gérer que celle du Covid, affirme le docteur Ocquidant.
« Par rapport à la crise du Covid, cela a été plus facile à gérer, car le seul transmetteur étant le moustique, les risques sont moindres qu’un patient en infecte un autre dans une même chambre, par exemple. »
En réponse au besoin de lits, certaines unités ont été réinvesties, et même des structures privées ont prêté main-forte. Une solidarité largement facilitée par la mise en place du Plan Blanc, ayant également permis un renfort de personnel médical venu de l’Hexagone et, localement, de personnel paramédical.

Concernant la vaccination, pour rappel, une campagne avait été lancée par le CHU le 7 avril dernier, mais finalement interrompue le 25 avril pour les personnes de plus de 65 ans à risque. Pour cause, l’Agence du médicament avait établi un lien entre des événements dits « graves », dont un décès, et le vaccin IXCHIQ. Pour en savoir plus sur ce vaccin, le CHU a lancé deux études pour mieux comprendre la vaccination contre le chikungunya à La Réunion.
Avec la première étude CHIK-RE-VAC, financée par l’ANRS, les infectiologues souhaitent en savoir plus sur l’efficacité du vaccin, qui, pour rappel, est administré en une seule dose. L’idée est de récolter des données sur sa capacité à prévenir les infections, hospitalisations et complications graves, mais aussi sur son immunogénicité (la production d’anticorps), ainsi que sur sa tolérance et ses éventuels effets secondaires. En parallèle, l’étude VAXCCEPTACHIK tend à mieux comprendre les motivations, freins et opinions de la population concernant la vaccination.
Sarah Cortier