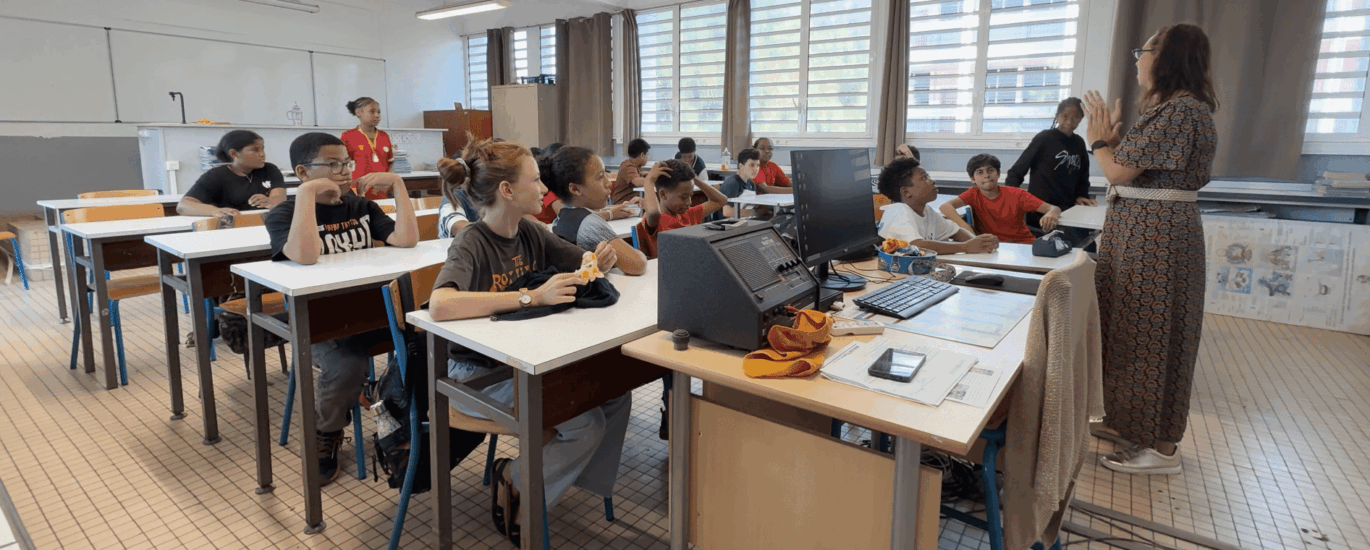LIBRE EXPRESSION#
Monsieur le Recteur,
Permettez-moi respectueusement de m’adresser directement à vous.
Tombé par hasard sur le texte, du plus haut intérêt à mes yeux, d’une motion relative à « Une école en harmonie avec notre société », qui a fait l’objet d’une délibération du Conseil régional en décembre 2023, j’ai cherché à en savoir plus auprès de mes connaissances enseignant dans l’EN. Il semblait bien que l’introduction, attendue depuis près de 25 ans dans l’Académie, d’un plan prenant en considération les réalités sociolinguistiques et socioculturelles vécues par les enfants créoles de la Réunion n’avait jamais encore été vraiment effectuée. Le temps a passé… Puis de fil en aiguille j’ai appris que votre nomination au Rectorat de l’Académie de La Réunion, permettait de relancer et d’actualiser cette problématique qui fait débat, dont j’avais déjà pris connaissance dès mon arrivée sur l’île, et dont je considère aujourd’hui que la non résolution participe à la crise qui altère le présent et l’avenir d’une partie non négligeable de la jeunesse réunionnaise, génération après génération.
L’annonce dont j’ai pris incidemment connaissance de la soumission d’un projet de PELCR au Conseil académique des langues régionales du 27 octobre prochain m’incite à m’adresser à vous.
Tout au long de mes engagements à La Réunion, bien qu’attentif à éviter tout généralisation abusive, il m’est tout de même apparu que la déscolarisation précoce, les problèmes persistants d’insertion sociale et professionnelle, le chômage chronique, la marginalisation, les crises mêmes d’identité personnelle pouvaient être considérés comme les symptômes et les conséquences de processus psychosociaux dont la banalité nous fait souvent oublier d’en analyser les causes profondes.
Alors que mes premiers contacts avec les gens qui m’accueillaient ici me faisaient découvrir dans nombre de familles l’interdiction imposée aux enfants de parler créole « pour ne pas en faire des ratés dans la société », je remarquais, presque simultanément ou quelques années plus tard, qu’après 10 ans d’enseignement exclusivement en français, une partie impressionnante de collégiens de 3ème étaient incapables d’écrire une phrase correcte dans cette langue. Et, de nos jours en dépit des mesures et des efforts consentis, j’observe que le nombre de personnes touchées par l’illettrisme demeure constamment au-dessus de 100 000, qui ne sont plus depuis longtemps de ces « gramoun qui n’ont jamais été scolarisés…
Ces découvertes répétées au long de mes années d’engagement, notamment auprès des jeunes « les plus éloignés de l’emploi » m’ont obligé à considérer la réalité : L’argument de la proscription du créole pour favoriser l’insertion n’a jamais rien changé… Toujours autant d’échecs, autant de désœuvrement, de déviances, de chômage et de désocialisation dans les générations qui se succèdent.
C’est face à la répétition ininterrompue de cette calamité que s’est imposée en moi la nécessité impérieuse de réconcilier le système d’éducation organisée de l’école avec la socioculture originelle de la plupart des enfants qui y pénètrent comme élèves. Il est vrai que tout le monde est connecté aujourd’hui et bénéficie de l’accès aux cultures de la planète entière. Mais dans les faits, rien dans les itinéraires individuels n’a véritablement changé. Certains parlent même d’aggravation…
Monsieur le Recteur,
Sans revendiquer la moindre légitimité à la rédaction de ce courrier, je suis tout de même préoccupé de partager mon témoignage, élaboré au cours des multiples situations de collaboration effectuée dans le cadre de l’Académie. Parmi les innombrables démarches et interventions auxquelles j’ai été associé (et que je ne peux toutes énumérer ici), je me permets juste de mentionner quelques épisodes qui me semblent déterminants, même si « je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans… !».
• Collège de Mongaillard – Projet de recherche sur la violence à l’école et dans le quartier, 1997-1999 (Proviseur Vie scolaire Daniel TAUPENOT et principal Daniel PAYET (homme remarquable))
• Intervention psychosociale sur le Collège de Plateau des Goyaves 1999 – 2001 (Principal Jean BRUN), puis 2009 – 2010 (Principal Jean-Luc DEFAUD)
• Animation de la journée académique des CIO, le 7 mai 1998, sur la problématique « Comment peut-on éduquer à l’orientation ? »
• Animation du débat sur l’avenir de l’école – Saint-Denis, le 16 décembre 2003 – Avec la présence de Claude THELOT (responsable national) et de Christian MERLIN (recteur de l’Académie de La Réunion)
• Les États généraux de l’outre-mer à la Réunion – en Juillet 2009 • Contribution à « KILTIR PARTOU LA RÉNYON LÉ AN NOU » – Commission éducation • « Une école réunionnaise : Une école ouverte sur le monde » (Document de présentation des Productions des commissions du Collectif, dont j’ai coordonné la rédaction et la publication.)
• Et bien d’autres encore…
Monsieur le Recteur,
Je parviens depuis longtemps à la conviction selon laquelle l’Académie rendrait une éminent service à la société réunionnaise entière (économie, institutions, climat social, culture…) en mettant en œuvre une approche opérationnelle réellement active en matière d’usage du créole dans le système scolaire, ainsi que de la prise en considération de la socioculture entière dont il est l’expression vivante.
Je souhaite que ce ne soit pas une banalité de rappeler que la langue maternelle est bien loin d’être un vulgaire outil de communication « domestique et familial ». Simple psychosociologue, ni linguiste ni historien, j’ai observé pendant de longues années à quel point la langue créole, marqueur identitaire reconnu à mon sens comme toutes les langues maternelles, est porteuse d’une façon de vivre, d’une façon singulière d’être au monde et de s’en construire une représentation complète et cohérente, encore aujourd’hui profondément opérante, en dépit des évolutions contemporaines aux tendances égalisatrices. Il m’apparaît comme une évidence incontournable qu’elle est le lien avec une histoire complexe toujours présente, souvent meurtrie, et qu’elle cimente la continuité des générations et la mémoire collective sur laquelle vient s’appuyer l’identité de chaque individu.
Dès le début, j’ai observé régulièrement à la Réunion que l’échec scolaire (et parfois social) avec ses conséquences est en rapport avec les dimensions sociolinguistiques et socio-culturelles qui font encore régulièrement l’objet de discussions, voire de dissensions périodiques, de conflits douloureux et de rejet dans les milieux « avertis ». Les vraies victimes de la rupture avec l’environnement qui les a formés, ce sont les dizaines de milliers de jeunes créoles aucunement préparés à cette aliénation. Dans mon expérience, il me semblait la plupart du temps que la honte de soi et la dissimulation s’installaient chez beaucoup d’entre eux, bien sûr masquées par une provocation défensive. Mais souvent, l’espoir d’une place estimable dans la vie s’était depuis longtemps estompé, emporté avec la prohibition de fait de son système de valeurs familiales et de ses objets d’identification.
Et très précisément, les « parcours d’insertion » incertains de tous ces jeunes dits « les plus éloignés de l’emploi » ne m’ont jamais appris qu’une chose : Dans ce circuit infernal, où la blessure du « moi profond » de l’individu s’aggrave de jour en jour, au long des trimestres et des années qui s’écoulent, l’élan vital et la croissance se ralentissent et parfois se brisent. Comment imaginer un avenir confiant et structurer un quelconque projet un peu crédible, alors que ses repères originels sont perdus et l’image de soi si dépréciée ?
Au cours d’une période que l’on peut espérer maintenant révolue, simultanément, je me suis interrogé en permanence sur les motifs qui empêchaient que soient réellement mis en œuvre les textes réglementant l’enseignement du créole réunionnais, accompagné de toute la culture qu’il exprimait, textes qui étaient publiés et utilisables il y a maintenant 25 ans au moins… Tout au long de ces années, j’ai éprouvé le sentiment que chez certaines élites créoles, intellectuelles et enseignantes, une sorte de servilité à un système encore marqué par le passé colonial était préférée à l’observation et à l’expertise. N’était-ce que l’effet de mon sentiment subjectif ? Ou bien avions-nous à faire à cette soumission à une hiérarchie dont plusieurs personnalités pourtant conscientes et réputées recherchaient les avantages supposés de l’approbation ? J’étais dans l’expectative. Peut-être s’agissait-il simplement de cet opportunisme individuel qui réduisait au silence pour ne pas déranger le système et risquer l’avenir de sa carrière, alors que la perception des conséquences pédagogiques et sociales de la situation, pourtant largement connues et dénoncées, aurait pu a minima inviter à une analyse empirique ? Ce ne sont que des questions banales qui ne visent personne bien sûr, mais qui ont en permanence interpellé en moi le simple témoin extérieur à l’institution. Mystères et contradictions des comportements humains et sociaux… Bien entendu tout cela appartient au passé.
Pour ma part, je salue l’opportunité offerte au Conseil académique des langues régionales de déclencher dès sa séance du 27 octobre, la mise en œuvre opérationnelle du PELCR soumis à son examen.
Il apparaît même cohérent aujourd’hui de procéder sans tarder à des mesures identiques à l’intention des élèves provenant de Mayotte et de l’archipel des Comores.
Pardonnez-moi pour finir, Monsieur le Recteur, de préciser ce qui en d’autres circonstances ne devrait même pas être effleuré. Les préoccupations dont je vous fais part ici n’ont aucune connotation politique, même si je ne suis pas dupe de l’usage qui pourrait en être fait. Mes convictions et mon statut exigent que je consacre ma réflexion exclusive aux dimensions psychosociales et sociétales d’un débat relatif à la jeunesse de ce pays auquel je dois tant, débat qui me tient à cœur depuis bien longtemps. En outre, les convictions exposées dans cet appel ne mettent nullement en cause l’impérative nécessité des exigences posées par l’éducation nationale.
En espérant enfin une évolution positive de la problématique exposée et en vous remerciant d’avoir bien voulu accorder votre attention à mes propos, je vous assure, Monsieur le Recteur, de mon profond respect.
Sainte-Clotilde, le 12 octobre 2025
Arnold Jaccoud
Psychosociologue
Chaque contribution publiée sur le média nous semble répondre aux critères élémentaires de respect des personnes et des communautés. Elle reflète l’opinion de son ou ses signataires, pas forcément celle du comité de lecture de Parallèle Sud.