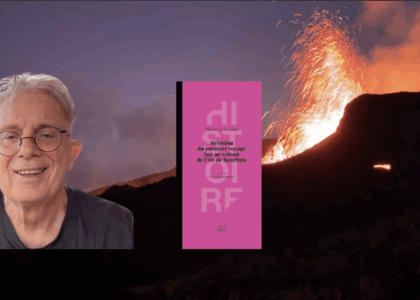Radio Sud Plus et Parallèle Sud s’associent pour proposer des débats de fond dans le cadre d’une série baptisée « Alé di partou ». La troisième émission s’est intéressée à la découverte des restes humains d’esclaves réunionnais dans les collections du Musée de l’Homme et leur devenir. Comment les restituer à La Réunion ?
Pour en parler autour des deux animateurs Nini et Olivier, il y avait Ghislaine Bessière du collectif réclamant la restitution des restes, Loran Hoarau l’historien, l’enseignante Dominique Vandanjon et le journaliste Franck Cellier. Klara Boyer-Rossol, l’historienne à l’origine de la découverte, intervenait au téléphone à partir de Paris. Elle a déjà encadré d’autres processus de restitution pour les bustes moulés de captifs mozambicains à l’île Maurice et pour les crânes de rois sakalava à Madagascar.
L’émission s’ouvre sur le récit de Klara Boyer-Rossol, historienne spécialiste des esclavages dans l’océan Indien, qui a mis au jour ces dernières années la présence de crânes et de bustes moulés d’esclavisés réunionnais dans les réserves du Musée de l’Homme à Paris. Son travail s’inscrit dans une recherche de longue haleine menée sur les collections anthropologiques issues des anciennes colonies françaises.
Les restes retrouvés à Paris proviennent principalement de deux séries de prélèvements opérés à La Réunion au 19e siècle :
En 1840, lors d’une escale à Saint-Denis, le phrénologue Pierre-Marie Alexandre Dumoutier, membre de l’expédition de l’Astrolabe, prélève des crânes à l’hôpital colonial et moule des visages de personnes vivantes et décédées, principalement des esclavisés mozambicains et malgaches.
Dans les années 1860, d’autres restes humains sont envoyés à Paris depuis l’hôpital colonial, en dehors de tout consentement et dans un contexte colonial profondément inégalitaire.
Des pratiques scientifiques marquées par le racisme colonial#
L’historien Loran Hoarau rappelle le contexte idéologique de ces prélèvements : au 19e siècle, la colonisation s’accompagne d’un discours scientifique prétendument rationnel qui hiérarchise les races humaines. La frénologie et l’anthropologie raciale se développent avec l’appui de l’État colonial et des institutions religieuses, dans un but de domination culturelle et politique.
Les corps noirs, particulièrement ceux des esclavisés, sont alors considérés comme des objets d’étude, privés de toute humanité.
« Le corps des dominés est vu comme un outil de recherche médicale, ethnologique, anthropologique » — Loran Hoarau.
Le cas réunionnais s’inscrit dans un système global de déshumanisation scientifique qui a aussi frappé les peuples d’Afrique australe, d’Océanie et d’Amérique latine.




Un choc mémoriel et émotionnel à La Réunion#
L’émission donne largement la parole à Ghislaine Bessière, représentante du collectif Rann Anou Nout zansèt, qui fédère 50 associations réclamant la restitution des restes humains. Elle évoque la douleur spirituelle ressentie par de nombreux Réunionnais face à la présence d’ancêtres dans des réserves muséales, parfois dans des boîtes anonymes.
« Ces ancêtres qui sortent du musée de l’Homme à Paris nous disent quelque chose. » — Ghislaine Bessière
Elle appelle à ouvrir les “cahiers de l’esclavage, de la colonisation et de l’engagisme” pour sortir du silence et de la honte. L’enjeu n’est pas seulement scientifique : il s’agit de faire reconnaître une mémoire trop longtemps tue et de permettre un travail collectif de deuil et de réparation.
L’émotion est aussi palpable dans les récits de Dominique Vandanjon, enseignante à la retraite, qui évoque la redécouverte de noms d’engagés et d’esclavisés oubliés, et les larmes de leurs descendantes lors d’une exposition.
Un soutien politique affirmé#
Durant l’émission, les animateurs diffusent à l’antenne un message envoyé par le député Frédéric Maillot, qui affirme son soutien au processus de restitution :
« Nou lé à la demande d’une vraie loi cadre pour la restitution totale de nos restes humains de nout band’ dans ce musée-là. Mais aussi pour que néna un vrai travail de fond pour savoir kosa néna ankor que la France i possède et que lé anou. » — Frédérique Maillot
Il annonce un colloque à La Réunion avec Klara Boyer Rossol et Corinne Toka Devilliers de l’association guyanaise Moliko pour co-construire le retour des restes humains avec les associations et les militants culturels.
Des noms, des visages, des histoires : reconstituer les trajectoires#
Klara Boyer-Rossol précise que les restes retrouvés sont attribuables à au moins douze individus, dont plusieurs sont nommés dans les archives : Valentin, Ifigénie, Pauline, Limbao, Dinyambane… Certains bustes ont été moulés post-mortem, d’autres sur des personnes vivantes interrogées à l’époque. « Ce sont leurs traits authentiques, pas des représentations », insiste-t-elle.
« J’ai pu pour le moment identifier en partie 12 personnes. La majorité était des dits Mozambiques ou Malgaches en fait des esclavisés déportés de l’Afrique orientale et de la Grande île. Et j’ai retrouvé parmi eux — et c’était extrêmement émouvant — un enfant créole qui s’appelle Limbao. Et ce qui est extrêmement fort, c’est que ces personnes sont nommées. On retrouve notamment Valentin. » — Klara Boyer-Rossol
La chercheuse propose de croiser les archives parisiennes et réunionnaises pour reconstituer les biographies individuelles de ces personnes déportées, réduites en esclavage, et utilisées comme matériel scientifique.


Quels cadres légaux pour la restitution ?#
L’enjeu juridique est crucial. Klara Boyer-Rossol rappelle que la loi française de 2023 sur la restitution des restes humains ne concerne que les pays étrangers. Aucun cadre légal n’existe encore pour les restitutions au sein du territoire national, bien qu’un projet de loi soit à l’étude pour 2025.
Elle distingue deux types d’objets :
- Les crânes et bustes post-mortem, juridiquement considérés comme restes humains, ne peuvent être utilisés qu’à des fins funéraires.
- Les moulages de personnes vivantes, eux, pourraient être exposés sous certaines conditions éthiques.
Cette absence de loi claire fragilise toute initiative locale et ouvre la voie à des décisions opaques.
Désaccord autour du lieu de restitution : le cas du musée de Villèle#
Le Département de La Réunion prévoit d’accueillir les restes dans le futur musée de Villèle, via une convention de prêt signée avec le Musée de l’Homme. Mais cette option est fermement rejetée par le collectif associatif :
« Hors de question de les remettre à Villèle, lieu de crime, de domination, d’oppression » — Ghislaine Bessière
Le président du Département, Cyril Melchior, avait répondu à Parallèle Sud que Villèle deviendra un lieu de mémoire rénové, apte à porter un discours scientifique qui « prendra ses distances avec les représentations dominantes. »
Mais le manque de transparence et l’absence de concertation avec la société civile sont vivement dénoncés par les intervenants.
Des propositions concrètes : mémoire, visibilité, pédagogie#
Le collectif demande l’ouverture d’un débat public, la création d’une commission scientifique pluridisciplinaire, et la mise en place d’une cérémonie spirituelle interreligieuse pour accueillir dignement les ancêtres.
Il rejette l’inhumation comme solution par défaut. Les bustes pourraient être exposés dans une salle dédiée au recueillement, permettant une réappropriation collective de cette mémoire.
« On n’est pas d’accord pour l’inhumation. Ce sont des visages avec lesquels il faut se reconnecter. Il faut rendre visible et accessible tous ces éléments qui font partie de notre patrimoine historique. » — Ghislaine Bessière
Enfin, les intervenants insistent sur l’urgence d’un travail pédagogique, notamment en milieu scolaire, avec des outils adaptés pour aborder ces questions sensibles dès le primaire.
Franck Cellier