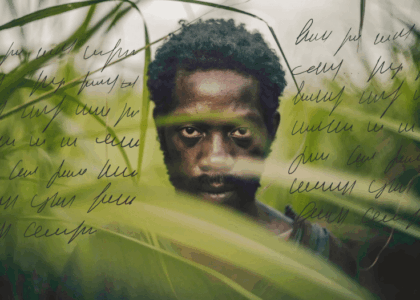Au début des années 1990, les programmes de mobilité se diversifient et les destinations se multiplient de manière exponentielle : il n’est plus seulement question de partir vers l’Hexagone, mais aussi vers les pays de l’Union européenne. La Grande-Bretagne et l’Allemagne deviennent des lieux d’accueil pour les jeunes travailleurs réunionnais, tandis que certains jeunes intellectuels vont parfaire leur formation dans les universités ou grandes écoles d’Amérique du Nord ou d’Australie. Plus récemment, le Québec est aussi devenu une destination de choix pour beaucoup de Réunionnais.
La mobilité commence à être pensée comme un outil au service des Réunionnais « ambitieux » voulant se former dans l’Hexagone ou à l’étranger. Mais dans les faits, cette politique reste toujours une parade face au manque de développement de l’île, maintenue en situation de dépendance vis-à-vis de sa métropole.
Ladom et la continuité territoriale#
Les années 2000 marquent un renouveau des programmes de mobilité, qui se basent désormais sur le principe de continuité territoriale. Celui-ci repose sur les « principes d’égalité des droits, de solidarité nationale et d’unité de la République »1. La continuité territoriale a pour but de renforcer la cohésion entre les différents territoires d’un même État, en compensant les handicaps liés à l’éloignement par la mise en place d’aides spécifiques aux citoyens vivant dans ces territoires éloignés.
En janvier 2010, l’ANT devient l’Agence de l’Outre-mer pour la Mobilité (Ladom). Un changement de nom qui traduit une évolution des compétences de l’ANT, auparavant exclusivement consacrée à la formation professionnelle en mobilité. L’Agence doit désormais assurer la mobilité des étudiants dont la filière est saturée ou inexistante sur place, et qui, pour ces raisons, souhaitent poursuivre leur parcours en dehors de leur territoire de résidence. Mais les dispositifs de mobilité s’ouvrent aussi aux habitants souhaitant se rendre en France hexagonale pour des raisons personnelles – comme la visite d’un proche.
Le 1er janvier 2016, Ladom est placée sous la tutelle du ministère des Outre-mer et du ministère du Budget, et bénéficie également du soutien financier de l’Union européenne via le Fonds Social Européen (FSE). L’augmentation des ressources de l’organisme permet de diversifier les programmes de mobilité.
En 2025, Ladom a mis en place 11 dispositifs de mobilité, répartis en quatre grandes catégories : vie étudiante, vie active, vie quotidienne et urgences de la vie. Ces programmes couvrent un large spectre de situations et permettent à toujours plus de Réunionnais de se rendre en Métropole.
Plus qu’une politique de régulation visant à apaiser les tensions liées au manque de développement de l’île, la mobilité est maintenant envisagée comme un outil au service de la population réunionnaise. Cette conception de la mobilité a poussé les collectivités territoriales d’outre-mer à occuper un rôle de plus en plus important dans l’organisation de la mobilité.
Le rôle de la Région Réunion#
De 2003 à 2010, la Région Réunion participe au financement des programmes de continuité territoriale, avec des suspensions temporaires liées aux retards de financement. La création de Ladom en 2010 marque la refonte et la recentralisation de la politique de continuité territoriale autour des acteurs étatiques nationaux. Cependant, la Région Réunion décide de renforcer ses propres programmes d’aides à la continuité territoriale, à côté du dispositif national.
Ces programmes sont distincts et entrent parfois en concurrence avec ceux de Ladom. De 2015 à 2020, à la suite d’un durcissement des règles de la continuité territoriale – notamment l’allongement du délai de carence de 1 à 3 ans entre chaque demande – les Réunionnais se détournent massivement des programmes de Ladom pour se diriger vers ceux de la Région. Dès 2016, 150 000 Réunionnais bénéficient des aides régionales, contre seulement 17 des bons de Ladom.
Cependant, selon le Code des transports, cette situation est illégale, la gestion de la mobilité étant une compétence de l’État :
« L’aide à la continuité territoriale relève d’une politique nationale de continuité territoriale […] confiée à Ladom. Il est donc clair que les collectivités régionales ne peuvent se substituer à l’État en la matière. »2
La Réunion a longtemps masqué l’insuffisance des financements nationaux par la mise en place de ses propres aides à la continuité territoriale. Face à cette situation, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé illégal, le 21 décembre 2022, le dispositif mis en place par la Région Réunion. Désormais, l’aide à la continuité territoriale se fait dans le cadre d’une convention entre la Région Réunion et Ladom.
On peut aussi noter que la Région a elle-même mit en place de nombreux programmes de mobilités vers l’international, dont des dispositifs spécifiques aux départs vers le Québec : « étudier et vivre au Québec ».
Les autres instances de la mobilité#
Aux côtés de Ladom et de la Région, l’Éducation nationale, le service civique et l’armée jouent également un rôle important dans l’organisation de la mobilité vers l’Hexagone. Bien qu’ils ne soient pas à proprement parler des dispositifs de mobilité, ces acteurs impliquent souvent le départ de Réunionnais vers la Métropole. Cependant, la mobilité des Réunionnais ne peut être résumée à des politiques d’État qui organisent, pour diverses raisons, le déplacement des habitants de l’île vers l’Hexagone.
En 2025, la mobilité est un phénomène bien installé dans la société réunionnaise. En 80 ans, elle est devenue un réflexe des dirigeants – qui reconduisent fréquemment ces politiques avec quelques ajustements – mais aussi un réflexe des habitants de l’île, qui, motivés par des raisons économiques et personnels, choisissent de partir en espérant trouver mieux de l’autre côté de la mer.
Permis par des solidarités familiales ou amicales, des milliers de départs ont lieu chaque année en dehors des filières organisées. Ces départs sont le fait de Réunionnais dont le projet académique, professionnel ou personnel ne rentre pas dans les cadres administratifs des dispositifs de mobilité.
Cette part non négligeable de personnes qui choisissent de ne pas passer par les filières organisées rend difficile l’établissement de statistiques précises sur la mobilité, contribuant à maintenir un flou sur l’ampleur réelle du phénomène.
Mais si partir est aujourd’hui un réflexe pour beaucoup de Réunionnais, la résistance à ces politiques est aussi très fréquente. Les Réunionnais, loin d’être des victimes de l’histoire inconscientes de leurs malheurs, ont au contraire très vite compris les enjeux des politiques de mobilité et en quoi celles-ci s’inscrivaient dans la continuité de la domination coloniale.
De la même façon qu’on ne peut pas faire l’histoire de l’esclavage sans l’histoire des révoltes d’esclaves, on ne peut faire l’histoire de la mobilité sans celle des résistances à celle-ci.
Les résistances à la mobilité#
Dès la période du Bumidom, la mobilité est vue par les forces de gauche – syndicats et partis – comme une politique qui vide l’île de sa jeunesse, pourtant essentielle à son développement.
En 1973, Roland Mallet déclare dans le journal de l’Union Générale des Travailleurs Réunionnais en France (UGTRF), Combat réunionnais, que le Bumidom organise un « commerce de chair humaine pour le profit de quelques capitalistes ». Il sera attaqué en justice par le préfet Vié et condamné, en juin 1975, à 300 000 francs CFA d’amende et à 500 000 francs CFA de dommages et intérêts au Bumidom.3

L’organisation de mouvements comme l’UGTRF montre que les émigrés réunionnais étaient conscients des enjeux implicites des politiques de mobilité et ont agi en conséquence. En 1972, à Lyon, les militants de l’UGTRF s’en prennent au foyer du Cnarm et aux bureaux lyonnais du Bumidom. Ils organisent ensuite un « commando » pour « attaquer le foyer du Cnarm » à Paris.
Cette résistance se manifeste également par la présence d’associations et de collectifs sur l’île et dans l’Hexagone. Ces groupes entretiennent des relations entre eux et coordonnent leurs actions. Le cas du collectif Profs 974 est très parlant : le lundi 17 mai 2010, une vingtaine d’enseignants affectés en Métropole s’enchaînent à l’intérieur du rectorat pour protester contre le départ forcé de jeunes professeurs réunionnais hors de leur département de naissance. Le lundi suivant, un rassemblement de soutien a lieu sur la place de l’île de La Réunion à Paris. Celui-ci rassemble le JERF (Jeunesse émigrée réunionnaise en France), le MRE (Mouvement des Réunionnais expatriés), Kreolokoz, la CNT-STE 92 (Confédération nationale du travail – Syndicat des travailleurs de l’éducation du 92) et le SEUL (Syndicat étudiant unitaire et laïque).
Même si l’opposition aux politiques de mobilité n’a pas toujours été couronnée de succès, l’essentiel du combat fut gagné. À La Réunion, le vieillissement de la population est plus lent qu’aux Antilles ; l’île a su garder sa jeunesse et, de la même façon, garantir son avenir, mais combien de temps durera encore ce sursis ?
La résistance s’est aussi incarnée dans les médias, où les opposants à la mobilité ont mené des campagnes de presse pour dénoncer la condition des jeunes Réunionnais, projetés dans un univers étranger sans préparation adéquate.
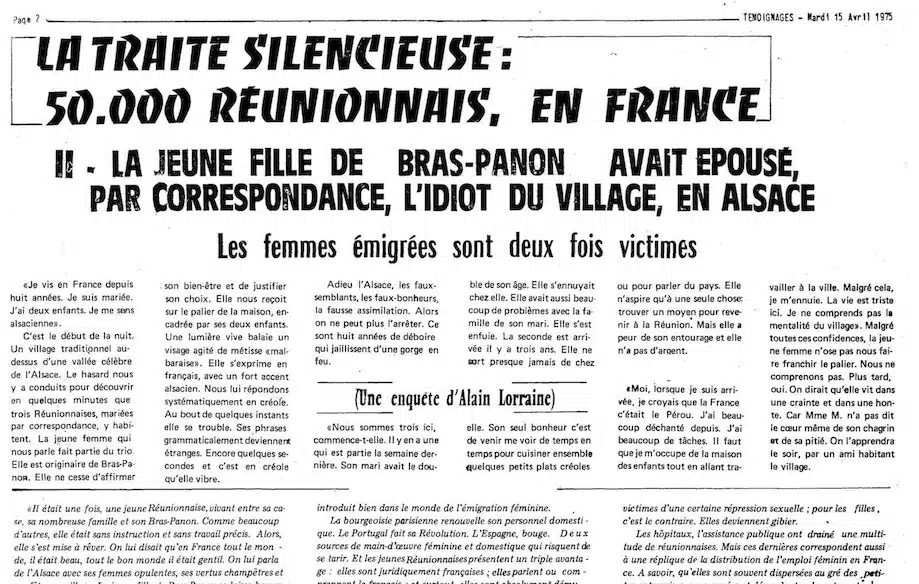
Les contenus postés aujourd’hui par les Réunionnais en Métropole sur les réseaux sociaux – qui soulignent, parfois sur le ton de l’humour, les difficultés de la vie en Hexagone – sont les lointains héritiers de ces campagnes de presse. Dans les deux cas, ils montrent les dommages psychologiques et émotionnels causés par le déracinement des Réunionnais partis vivre en Métropole.
Notre prochain article explorera cette question : qu’est-ce que ça fait de vivre en Hexagone quand on est Réunionnais ?
Mathieu BELLUTEAU