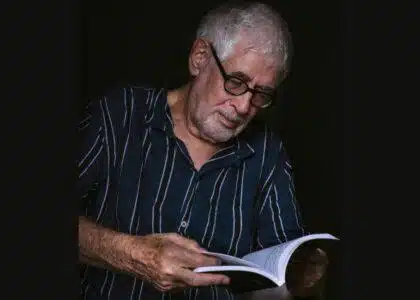LIBRE EXPRESSION#
Le contexte actuel incite aux revendications. Et il y a de quoi !
La cherté de la vie, le manque problématique de logements, le caractère chronique du chômage sont les problèmes fondamentaux qui préoccupent de façon continue les populations réunionnaises.
Et à ces raisons légitimes de récriminations viennent s’ajouter périodiquement les interminables attentes de réparations et de reconstructions liées aux catastrophes météorologiques, l’introuvable résolution des conditions d’une retraite empreinte de justice et de dignité, les vacillations plus qu’incertaines des dispositifs destinés à l’insertion des jeunes générations dans le tissu économique et social, la dénonciation des défaillances d’un système sanitaire constamment en retard d’un combat ou le casse-tête insoluble des violences intra-familiales…
Bref nous avons de quoi réclamer et solliciter, dans ces domaines complexes et enchevêtrés dans lesquels se joue la survie matérielle et financière, ou le présent et l’avenir de segments entiers d’une population malmenée, plongée dans les inégalités sociales et économiques, et perdue dans l’amertume du sentiment de non-écoute et d’abandon.
Et soudain, les médias se font -bien trop modestement- l’écho d’une revendication qui ne réclame ni investissement financier, ni attente matérielle. Des associations réunionnaises interpellent la métropole pour que leur soient restitués les moulages de bustes et de crânes d’esclaves réunionnais, retrouvés dans les réserves du Musée National d’Histoire Naturelle / Musée de l’Homme de Paris. « Rann anou nout zancèt ! » Il faut lire à ce sujet l’article détaillé et remarquable de Franck Cellier, publié dans Parallèle Sud le 5 mars dernier.
À l’évidence, on peut s’attendre à une multitude d’analyses, d’interprétations et surtout de commentaires, relatifs à la découverte de ces artefacts ancestraux et notamment à la réclamation de leur restitution dans leur terre d’origine.
La lecture qui s’est imposée à mon esprit me conduit à considérer le double caractère, à la fois social et spirituel, de la démarche opérée par cette cinquantaine d’associations vouées à un opiniâtre travail de mémoire. Elles sont accompagnées d’un nombre grandissant d’individus, et soutenues de plus activement par un de nos députés à l’Assemblée nationale.
Premièrement, le besoin impérieux de retrouver, restaurer, réhabiliter, honorer ses racines originelles relève à mes yeux des valeurs les plus élevées de l’esprit humain. Personne ne peut jamais se sentir véritablement complet, confronté à la discontinuité mutilée des générations qui l’ont précédé. Et surtout lorsque ces racines plongent dans les intolérables souffrances des conditions de déshumanisation imposées sans pitié aux populations esclavisées.
Que l’on ne partage pas la totalité de l’argumentation des initiateurs de cette requête ou de ses diverses séquences opérationnelles ne diminue en rien le respect intégral dû à des convictions dont le symbolisme intense remplace sans réserve la quête de bienfaits matériels, habituelle à tant de revendications répétitives. On touche ici à la conscience existentielle collective, tant l’entretien vivant des liens avec les ancêtres est inscrit en profondeur dans les sociocultures de nos régions.
Secondement, je crois ne jamais oublier que le pouvoir social d’un groupe ou d’un peuple, son pouvoir d’agir, reflète ses capacités à mettre concrètement en valeur son histoire et ses racines, source d’identité, de fierté et de singularité, à maîtriser un présent toujours mouvant, à se projeter dans des futurs possibles, raisonnables et réalistes.
Le peuple réunionnais semble trop souvent privé de ce pouvoir d’agir sur son destin. En anglais on disait « empoverment », signifiant qu’il s’agit de « ce processus par lequel les personnes, les organisations et les communautés acquièrent le contrôle des événements qui les concernent ».
Bien entendu la revendication dont il est question ici semble parfaitement dérisoire, infime et microscopique en regard des grands problèmes de notre actualité. Elle ne changera rien aux réalités vécues. En apparence seuLement. Car le sentiment de ne pas être complet, entier dans la perception de la succession des générations, génère de multiples formes d’impuissance existentielle. Et celle-ci nourrit la souffrance et l’inhibition chronique de l’action. Ou quelquefois cette tension interethnique latente, pétrie de révoltes et de frustrations contenues que l’on connaît bien à La Réunion. Et on la neutralise le mieux possible au nom du « vivre ensemble ». Ce qui aide à en limiter les méfaits. Mais la dignité, elle, passera toujours par le rétablissement de l’action.
J’ai constamment à l’esprit que, lorsqu’une population, dans ses rapports avec les systèmes institutionnels établis, ne parvient pas durablement à faire valoir ses besoins profonds et lorsqu’elle continue à se sentir maintenue dans une posture de soumission contrainte, alors on voit perdurer la prévalence des intérêts sectoriels, des stratégies anarchiques de défense et de déresponsabilisation, en même temps que la dévastation des modes de vie et des identités culturelles les plus fragiles.
Pour exister, un peuple ne vit pas uniquement de matérialité et de confort économique même relatif. Si j’en juge les informations diffusées par les médias, partout dans les outre-mer, les populations sont agitées dans les soubresauts enclenchés par la récupération de leur pouvoir d’agir que le contexte géopolitique persiste à leur dérober. Toute démarche, si microscopique qu’elle puisse être, appartient certainement à ce mouvement de restauration. Le devoir de mémoire sans cesse réactivé, la réinscription, dans le concret d’aujourd’hui, de l’histoire de ses ancêtres. en font intimement partie.
La restitution des représentations des ancêtres, abandonnées dans les collections muséales métropolitaines, peut contribuer avec force à compléter l’histoire patrimoniale de La Réunion. Elles n’évoquent pas seulement la mémoire de l’esclavage qui hante perpétuellement nos consciences, elles rappellent que le peuple réunionnais entier s’est construit dans la souffrance et les duretés de l’existence. Cette restitution pourrait bien être un signe, même imperceptible par la majorité, que l’appropriation de notre pouvoir d’agir sur le destin de La Réunion, ne peut passer que par nous et nos engagements.
Je crois qu’une pétition circule pour soutenir la démarche de restitution entamée. Il m’apparaît que le peuple réunionnais en son entier devrait la soutenir sans la moindre restriction.
Arnold Jaccoud
À propos de la restitution : un enjeu de mémoire et de justice#
La question de la restitution occupe une place centrale dans cet article. Il s’agit ici de mettre en lumière une démarche portée par des associations réunionnaises qui réclament la restitution de bustes et de crânes d’esclavisés conservés en métropole. Cette restitution n’est pas seulement une affaire de patrimoine, mais un acte profondément symbolique, lié à la mémoire, à l’histoire et à la dignité des ancêtres. À travers cette restitution, c’est tout un peuple qui affirme son besoin de reconnaissance et son droit à réparer une part occultée de son passé. En cela, la restitution constitue un geste de justice mémorielle, essentiel à la construction identitaire de La Réunion.
Chaque contribution publiée sur le média nous semble répondre aux critères élémentaires de respect des personnes et des communautés. Elle reflète l’opinion de son ou ses signataires, pas forcément celle du comité de lecture de Parallèle Sud.