REPUBLICATION – pendant les vacances, Parallèle Sud repart dans ses archives et propose aujourd’hui un article paru une première fois le 7 avril 2025. Dimanche 30 mars, c’était l’occasion pour toute la communauté moringue de l’île de La Réunion de se réunir à Saint-Pierre et de mettre en avant ce sport traditionnel, longtemps marginalisé, aujourd’hui en plein renouveau. À cette occasion, nous avons rencontré Jérémy Rubegue, président de l’association Moringue Angola et professeur, ainsi que Billy Johny, chanteur de maloya et porteur d’une mémoire précieuse.
« Moring lè la ». Voilà les mots prononcés par le speaker ce dimanche 30 mars alors que pour la première fois de l’année les moringueurs de l’île se réunissent à Saint-Pierre.
Le moringue : un art martial, un chant, une mémoire#
À première vue, le moringue pourrait ressembler à de la capoeira, avec ses mouvements circulaires, ses jeux de jambes acrobatiques et sa musique entraînante. Mais derrière les gestes, c’est toute une histoire — ou plutôt une mémoire — que porte cette pratique. Le moringue est né à La Réunion durant l’esclavage, dans le sillage des souffrances et des résistances des Africains déportés. « Le moringue en fait, c’est un Gramoun qui me l’a raconté, comme quoi son grand-père avait été esclave », confie Billy Johny. « C’était un vieux pêcheur de Saint-Leu et tous les jours, pendant que son radeau séchait sur le mur de l’école, il me racontait des histoires sur le maloya et le moringue ».
À l’époque, les esclaves n’avaient pas le droit de se battre, de s’organiser, ni même de transmettre leur culture. Alors ils ont caché leur art dans la musique, dans la danse, dans le rythme des vagues. « La jing du moringue, elle rappelle celle des esclaves lorsque les marchands les faisaient sauter sur place à coups de bâton pour qu’ils soient en forme lors de la vente. La garde, l’utilisation unique des pieds, c’est parce que les mains étaient attachées. »
Une histoire effacée, des pratiques interdites#
Malgré ses racines profondes, le moringue, comme le maloya, a longtemps été réduit au silence. Jusqu’au début des années 1980, ces pratiques étaient interdites par les autorités. Considérées comme subversives ou “folkloriques”, elles étaient marginalisées dans l’espace public et absentes des institutions. Ce bâillonnement culturel trouve ses racines dans un prolongement de la mainmise coloniale sur les savoirs et les traditions des outre-mer. « Les anciens ne voulaient pas qu’on connaisse cette histoire-là. Ils avaient peur, parce que c’était interdit. »
Cette fracture a laissé des traces. « Il y a beaucoup de gens à La Réunion qui connaissent pas vraiment leur culture. Ils sont dans les visuels d’ailleurs, ils oublient qu’ici, il y a un potentiel énorme », explique Jérémy Rubegue. Pour lui, redonner sa place au moringue, c’est réparer cette mémoire abîmée et rétablir un lien de fierté culturelle.

La codification et la transmission du moringue#
C’est notamment grâce à des figures comme Billy Johny et d’autres pionniers que l’histoire du Moringue a pu émerger de l’ombre. Ces personnalités ont joué un rôle crucial dans sa préservation et sa transmission aux nouvelles générations. Parmi eux, on trouve Ernaud Iafare, qui découvre le moringue dans les années 1990, alors que celui-ci connaît un renouveau.
Ce dernier fonde en 1997 le Comité Réunionnais de Moringue, soit un an après sa reconnaissance par l’État français. Ce fut à cette époque que le moringue a commencé à être codifié sous une forme plus sportive. Si cette codification a permis au moringue de se structurer et d’acquérir une reconnaissance institutionnelle, elle a aussi un peu éloigné l’art de certaines de ses racines traditionnelles.
Ernaud Iafare souligne cependant que « le Moringue étant un art vivant, il ne faut pas l’enfermer dans un cadre trop strict pour le laisser évoluer ». Le Moringue, pour lui, reste un trait d’union entre le passé et le futur, car il nous raccroche à l’histoire toujours en mouvement de l’île de La Réunion.
Dans son ouvrage, Moringue, danses de combats et danses festives, Karl Kugel rappelle la « culture d’origine commune » avec les autres formes de danses de combat tout en observant « une créolisation des rituels de défi, de jeu et de combat ». 1
Un art martial, mais aussi un lien social#
Le Moringue ne se limite pas à la pratique du combat. Il est aussi un moyen de se déconnecter du quotidien, de se détendre et de maintenir un lien avec l’histoire et la culture réunionnaises. Jérémy Rubegue précise que c’est un moyen de « travailler son cardio », mais aussi de « se protéger et de se ressourcer ».
Les pratiquants viennent non seulement pour apprendre les techniques de combat, mais aussi pour découvrir l’histoire et les valeurs qui se cachent derrière cette discipline.
Le moringue aujourd’hui : un art martial et une culture vivante
De nos jours, le moringue est bien plus qu’un sport. Il est devenu un symbole de l’identité réunionnaise, que ce soit dans ses dimensions culturelle, sociale ou historique. Ce sport, autrefois marginalisé, attire aujourd’hui un large public, non seulement pour ses aspects physiques et acrobatiques, mais aussi pour le message culturel qu’il véhicule. Il incarne à la fois une mémoire collective et une projection vers l’avenir.
Lors de l’événement de Saint-Pierre, le moringue a montré qu’il est bien plus qu’une discipline. Il représente un héritage vivant qui relie l’histoire douloureuse de l’esclavage à l’avenir prometteur de La Réunion. Grâce à des passionnés comme Billy Johny et Jérémy Rubegue, cet art retrouve sa place dans le paysage culturel réunionnais et au-delà.
Olivier ceccaldi
- Moringue, danses de combats et danses festives – Karl Kugel p. 9 ↩︎











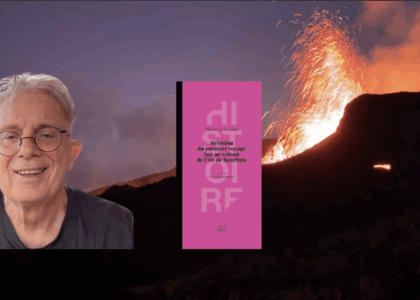



⚠︎ Cet espace d'échange mis à disposition de nos lectrices et lecteurs ne reflète pas l'avis du média mais ceux des commentateurs. Les commentaires doivent être respectueux des individus et de la loi. Tout commentaire ne respectant pas ceux-ci ne sera pas publié. Consultez nos conditions générales d'utilisation. Vous souhaitez signaler un commentaire abusif, cliquez ici.