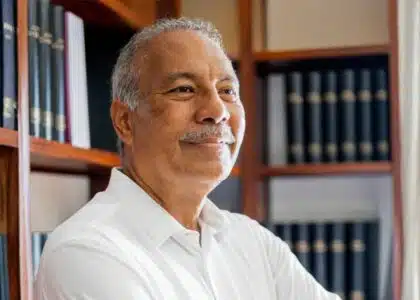LIBRE EXPRESSION#
Le 1er octobre 2009, le maloya entrait au patrimoine immatériel de l’humanité. Douze ans plus tard, cette date devrait être un moment de feu, une communion, une révolte joyeuse. Elle devrait être l’équivalent de notre 14 juillet culturel : tambours battants, kayamb secouant, roulèr grondant dans chaque commune, chaque quartier, chaque marmite. Pourtant, qu’a-t-on fait de ce 1er octobre ?
On l’a laissé se couvrir de bruits étrangers, de concepts importés, de programmations qui n’ont rien à voir avec notre âme. Ce qui devait être la fête du maloya devient une cacophonie où le cri des ancêtres est noyé par des sons qui ne portent aucune mémoire de l’esclavage, aucune cicatrice de la plantation, aucune vibration de nos ravines.
Faut-il rappeler ce qu’est le maloya ? Il n’est pas né pour distraire, mais pour survivre. Dans l’ombre des champs de canne, les esclaves brisés inventaient ce rythme pour ne pas mourir en silence. Chaque battement de roulèr, c’était un coup de sagaie contre l’effacement. Chaque chant, une manière de dire mwin lé vivan. Longtemps, ce chant a été interdit, réprimé, méprisé. Chanter le maloya, c’était risquer le stigmate de la subversion. Et aujourd’hui, alors qu’il est enfin reconnu par le monde entier, voilà qu’on le réduit à une case décorative dans un calendrier saturé d’événements qui n’ont rien de réunionnais.
Il y a une forme de colonisation nouvelle dans cette situation. Non plus avec des chaînes de fer, mais avec des programmations culturelles hors sol. Non plus avec des fouets, mais avec des logiques marchandes. L’arme n’est plus la censure explicite, mais la saturation. On ne vous dit plus « taisez-vous ». On fait mieux : on vous recouvre de bruit jusqu’à ce que votre voix ne s’entende plus. C’est une stratégie bien connue : étouffer un cri en le noyant dans le vacarme. Or ce vacarme, aujourd’hui, tombe exactement sur la semaine où nous devrions fêter notre identité.
Face à cela, deux bastions tiennent encore debout : les festivals Gayar et OI Fest Afrika. Eux seuls portent le flambeau du maloya comme marqueur identitaire, eux seuls refusent la folklorisation, eux seuls osent dire : le 1er octobre est sacré. Là, le maloya n’est pas une simple animation, il est le cœur battant. Là, on ne vient pas consommer un spectacle, on vient partager un kabar, respirer une mémoire, faire vivre un peuple.

Mais la menace est réelle. Car à force de voir d’autres concepts occuper l’espace, la mémoire populaire se brouille. L’anniversaire du maloya devient invisible, relégué, presque honteux. Comme si notre cri n’avait pas sa place dans notre propre maison. Comme si nous devions nous excuser de vouloir vibrer à notre rythme.
Ce n’est pas anodin. C’est une forme de dépossession. Une manière de dire : vous pouvez garder vos tambours dans vos marges, mais les grandes scènes, elles, seront pour d’autres sons, d’autres codes, d’autres cultures. C’est exactement ce que nos ancêtres redoutaient : disparaître au milieu du vacarme des maîtres. Et voilà que cela recommence, sous des formes modernes, avec des sponsors et des projecteurs, mais la logique reste la même : invisibiliser ce qui dérange, occuper la place avec autre chose.
Alors il faut le dire sans détour : fêter le maloya est un acte de résistance. Défendre cette date du 1er octobre, c’est défendre notre dignité. C’est dire que nous ne sommes pas une île quelconque, mais un peuple avec une histoire spécifique, une mémoire douloureuse, une musique unique. Le maloya est à La Réunion ce que le blues est aux États-Unis : un cri d’esclaves transformé en identité universelle. Imagine-t-on qu’on remplace la fête du jazz à La Nouvelle-Orléans par une foire de musiques sans racine ? Pourquoi accepter que cela se produise ici ?
Il faut prendre le couteau entre les dents, la sagaie dans les mains, et rappeler que cette date est la nôtre. Ce n’est pas une option. Ce n’est pas un folklore. C’est une obligation historique. Ne pas fêter le maloya le 1er octobre, c’est cracher sur les esclaves qui l’ont inventé, c’est trahir les militants qui l’ont défendu quand il était interdit, c’est priver nos enfants d’un héritage qui fait d’eux des Réunionnais debout.
Ce combat ne se gagnera pas dans les salons climatisés ni dans les communiqués officiels. Il se gagnera dans les kabar, dans les roulèr qui frappent jusqu’à épuisement, dans les kayamb qui secouent la mémoire, dans les voix qui refusent de s’éteindre. Le maloya est un feu. Si nous ne l’entretenons pas, il s’éteindra sous la pluie des programmations exogènes. Mais si nous le nourrissons, il embrasera tout un peuple.

Le 1er octobre ne doit plus être une date ordinaire. Il doit être un brasier. Et ce brasier, aujourd’hui, brûle surtout dans les festivals Gayar et OI Fest Afrika. Là, le peuple réunionnais se retrouve. Là, la mémoire des ancêtres danse. Là, la liberté respire. À nous d’en faire le cœur battant de notre calendrier, malgré le vacarme qui tente de l’étouffer.
Patrice Sadeyen
Chaque contribution publiée sur le média nous semble répondre aux critères élémentaires de respect des personnes et des communautés. Elle reflète l’opinion de son ou ses signataires, pas forcément celle du comité de lecture de Parallèle Sud.