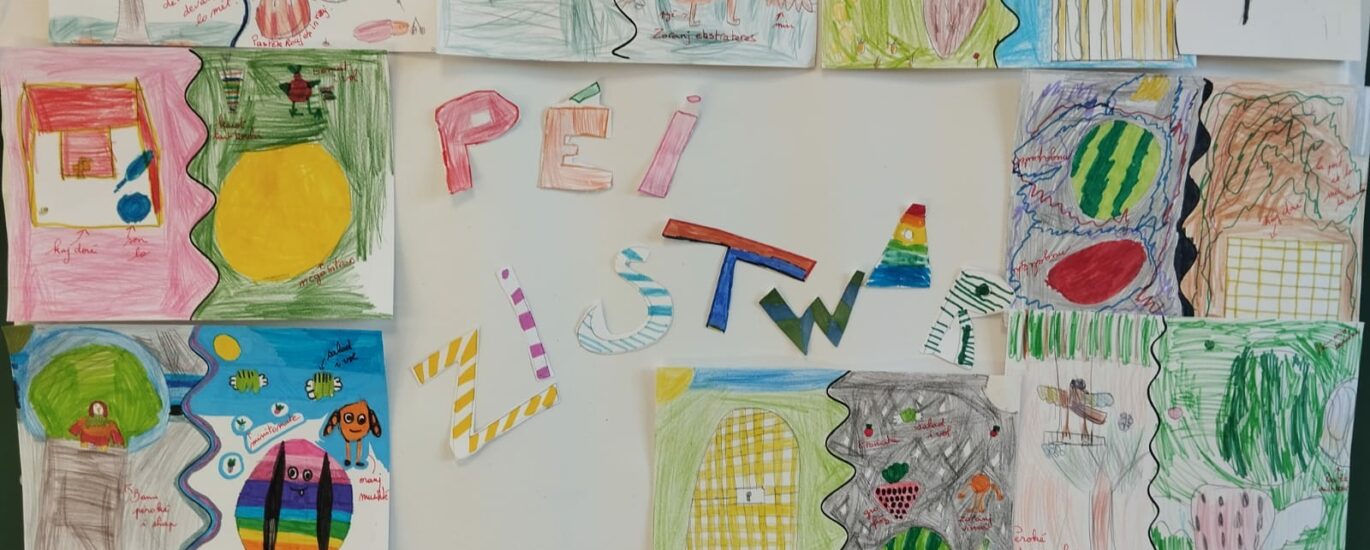LIBRE EXPRESSION – Suite aux articles de Parallèle Sud paru sur le refus par le recteur d’un plan citoyen pour l’enseignement du créole car jugé trop politique, Patrice Sadeyen souhaite réagir notamment par rapport à la réponse du recteur lui-même.
Il y a, dans cette scène familière qui se répète depuis quarante ans, quelque chose de terriblement révélateur : dès qu’il s’agit du créole réunionnais, l’institution recule, se crispe, invente un prétexte. Aujourd’hui, ce prétexte s’appelle le « caractère politique ». Le Plan pour l’enseignement de la langue et de la culture réunionnaises (PELCR) serait trop engagé, trop chargé d’intentions, trop proche du combat de celles et ceux qui portent la langue depuis toujours. Mais que serait une langue vivante, une langue maternelle, une langue d’un peuple, si elle n’était pas justement traversée par un combat ?
La question qui brûle les lèvres est simple : aurait-on osé opposer cet argument à un plan corse ? à un plan basque ? à un plan breton ? L’histoire récente répond pour nous : jamais un recteur ne s’est permis de disqualifier les propositions corses ou basques en les renvoyant à leur caractère « militant ». Là-bas, la revendication linguistique est reconnue comme légitime, enracinée, vieille de plusieurs générations, inscrite dans un rapport de force assumé. Ici, à La Réunion, la même revendication devient soudain suspecte, trop passionnée, trop indocile pour entrer dans les tiroirs d’une académie de la République.
Le rectorat explique que le PELCR serait « un texte à caractère politique ». Comme si la défense de la langue maternelle pouvait être autre chose qu’un acte politique. Comme si l’institution avait le luxe de prétendre gérer une langue comme on gère une procédure administrative. Comme si ceux qui ont porté le créole pendant des décennies, souvent dans le mépris, dans le silence, dans l’invisibilité, devaient maintenant s’excuser d’avoir une vision, un projet, une ambition pour le pays.
Le pire n’est pas dans le rejet. Le pire est dans l’habillage du rejet, dans cette manière de dire que l’on comprend, que l’on partage, que l’on converge — tout en refusant sèchement l’étape symbolique qui aurait enfin donné une reconnaissance pleine au travail d’un collectif de parents, d’enseignants, d’artistes, de chercheurs, de militants. L’institution se félicite de reprendre « 70 à 80 % » des propositions du PELCR. Elle absorbe les idées, mais elle refuse de reconnaître celles et ceux qui les ont formulées. Elle puise dans la force du mouvement créolophone, mais elle continue à maintenir ce mouvement hors des instances qui décident.
C’est un procédé parfaitement colonial : utiliser les idées venues du terrain tout en décrédibilisant les porteurs de ces idées, rappeler que la seule parole qui vaut est celle qui est estampillée par l’État, maintenir le créole dans une zone grise, utile mais jamais souverain.
Ce débat ne porte plus seulement sur un plan. Il porte sur la place que l’institution accorde — ou refuse — à la langue qui naît dans la bouche des enfants de l’île. Le créole reste toléré tant qu’il reste décoratif : un « plus », un atout culturel, une jolie couleur locale à sortir aux journées du patrimoine. Dès qu’il devient outil pédagogique, dès qu’il devient support de savoir, dès qu’il devient vecteur d’émancipation, l’institution recule, paniquée par la perspective d’une langue qui ne serait plus folklorisée mais pleinement assumée.
Les mêmes acteurs qui refusent de voter sur ce plan savent pourtant que toutes les études convergent : une école ancrée dans la langue maternelle réussit mieux. Les enfants apprennent mieux. Les écarts se réduisent. Les identités se renforcent. Mais reconnaître cela, ici, supposerait d’admettre que la langue créole est une langue de savoir, une langue de légitimité, une langue suffisamment digne pour être inscrite dans un plan élaboré par la société civile. Et cette dignité-là, on la réserve pour d’autres langues régionales, celles qui ne souffrent pas du soupçon permanent d’infériorité collé aux territoires coloniaux.
Lorsque le recteur affirme que l’administration d’État doit conserver la maîtrise exclusive des orientations linguistiques, il ne dit rien d’autre que ceci : la langue créole n’appartient pas à ceux qui la parlent, elle appartient à ceux qui la réglementent. Et cette logique nous ramène directement à ce que La Réunion subit depuis trop longtemps : une gestion externe de son identité, une surveillance sourde de ce qui pourrait ressembler à une affirmation culturelle non autorisée.
Le refus de soumettre le PELCR au vote n’est pas un simple détail procédural. C’est un signal. Un rappel. Une frontière. On dit aux Réunionnais que leur langue doit rester enfermée dans un cadre que d’autres définiront. On leur dit que leur créativité est bienvenue, mais leur pouvoir de décision ne l’est pas. On leur dit que le créole peut exister, mais qu’il ne doit surtout pas déranger.
Et pourtant, cette langue dérange depuis le premier jour où elle a été prononcée sur cette terre. Elle dérange parce qu’elle est née en dehors de l’ordre imposé. Parce qu’elle est la preuve vivante que les dominés inventent toujours ce que les dominants ne peuvent pas contrôler. Parce qu’elle porte une mémoire qui refuse de s’effacer.
Ce que révèle cette affaire, ce n’est pas un désaccord technique entre un rectorat et un collectif. C’est une fracture beaucoup plus profonde : celle qui sépare la parole institutionnelle, qui s’imagine neutre, et la parole réunionnaise, qui doit encore se battre pour exister. C’est la fracture entre une vision administrative de la langue — froide, hiérarchisée, centralisée — et une vision populaire — vivante, enracinée, indocile. C’est la fracture entre ce que la République dit défendre et ce qu’elle défend réellement.
On peut répéter tous les discours bienveillants du monde. Tant que l’institution refusera d’accorder au créole la même dignité qu’au corse ou au basque, tant qu’elle considérera la mobilisation réunionnaise comme une passion suspecte, tant qu’elle cherchera à filtrer la légitimité culturelle depuis un bureau métropolitain, il faudra continuer le combat.
Parce que derrière ce refus administratif, il y a une vérité que personne ne veut vraiment regarder : accepter le créole, pleinement, c’est accepter que La Réunion ait une identité propre, une mémoire propre, un rapport au monde qui ne soit pas toujours aligné sur celui de Paris.
Et ça, pour certains, c’est encore trop politique.
Patrice SADEYEN
Chaque contribution publiée sur le média nous semble répondre aux critères élémentaires de respect des personnes et des communautés. Elle reflète l’opinion de son ou ses signataires, pas forcément celle du comité de lecture de Parallèle Sud.