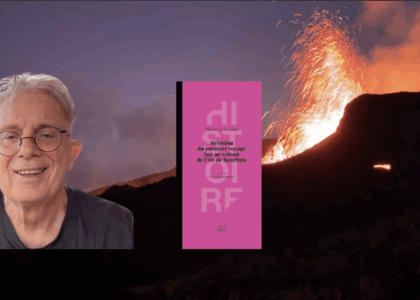La deuxième édition du FIFOI (Festival du film de l’Océan Indien) qui s’est tenue du 5 au 9 avril entre Saint-Paul et Saint-Leu, a de nouveau mis à l’honneur des films venus des quatre coins du bassin de l’Océan Indien. Cette année, et pour la première fois, le festival a souhaité créer en parallèle un espace privilégié d’échange pour les professionnels du cinéma avec le marché du film. Au programme : pitchs, ronkozés et conférences.
Ce mardi 8 avril, cela faisait déjà deux jours que le lancement officiel du FIFOI avait été célébré. Après une soirée d’ouverture au Musée Stella Matutina, et une première soirée de projection des films de long-métrage en compétition, une session de pitch a lancé cette nouvelle journée de festival, à l’hôtel du Récif, à la Saline-les-Bains.
Dès 9 h, sept réalisateurs de diverses nationalités se sont succédé devant un public de professionnels pour pitcher leur projet de long-métrage documentaire à la recherche de producteurs et de diffuseurs. Au programme : traditions botaniques malgaches, violences sexistes et sexuelles en Afrique du Sud, Karnon (carnaval malbar), vasectomie et rapport à la non-paternité, déplacement des enfants métis franco-malgaches pendant la période indépendantiste, et pesticides agricoles à Madagascar.
Pour Tatiana Botovelo, réalisatrice franco-malgache venue pitcher son projet, c’est l’occasion de rencontrer des acteurs et des institutions du cinéma de l’Océan Indien. « Je découvre qu’il y a toute une industrie qui se met en place pour créer un cinéma indépendant et solidaire sans besoin d’aller chercher de l’argent en Europe et aux États-Unis. » s’enthousiasme-t-elle.
Le marché du FIFOI permet à la fois de découvrir le cinéma de l’Océan Indien mais aussi de réseauter entre professionnels. « La partie écriture et financement de mon film est terminée, on entre maintenant dans la partie développement avec un début de tournage prévu pour septembre prochain. Ensuite, on va entamer la phase de demandes des aides pour la production (montage, étalonnage…), où il nous faudra obligatoirement avoir un diffuseur. Ça peut nous coincer pendant des mois, donc on essaye de trouver un diffuseur en amont et certains veulent signer avant le tournage pour pouvoir y assister et donner leur avis. Tout à l’heure, j’ai pu échanger après la phase de pitch avec des réalisateurs, producteurs, diffuseurs et programmateurs de festival. Ça permet de faire du réseautage et d’avoir des avis sur notre pitch de différents acteurs de l’audiovisuel », explique-t-elle.
Pour ces artistes, réalisat.eur.rice.s, scénaristes, pitcher leurs films revient à présenter à des professionnel.le.s du métier un bébé qui voit le jour. Mais pour le faire grandir, il va leur falloir de l’aide.

Avec qui produire et diffuser son film : un choix décisif#
Cette session de pitch a précédé deux tables rondes. La première a rassemblé, autour de la thématique « Coproduction internationale », Yolanda Ncokotwana, cheffe du département du développement de l’industrie au NFVF (Afrique du Sud), Pedro Pimenta, producteur et consultant ayant travaillé dans plusieurs pays africains sur des documentaires et longs-métrages, et Mathieu Béjot, attaché audiovisuel en Inde. Pour faire simple, la coproduction internationale d’un film, c’est en fait une ou plusieurs sociétés de production nationales qui s’associent avec d’autres sociétés étrangères pour financer la production du film en question. Dans le cadre d’un festival international, cette étape du processus de création d’un film prend tout son sens.
Lorsque l’on a travaillé sur un film, et que l’on envisage la coproduction internationale, plusieurs risques et enjeux apparaissent. Yolanda Ncokotwana explique : « Ce qu’il faut aussi avoir en tête, c’est de ne laisser personne coloniser votre projet. De ne laisser personne mal interpréter le message que vous souhaitez faire passer, ou mal représenter la culture et l’identité dans lesquelles s’inscrit votre film. Il y a aussi des enjeux de lutte contre le racisme derrière ces choix de production. »
Pedro Pimenta ajoute, à destination des réalisateur.rice.s, scénaristes, etc. : « Votre projet, et faire du cinéma en règle générale, cela prend du temps, de l’énergie, il faut être endurant. Donc, il ne faut pas sous-estimer votre travail, c’est quelque chose que je vois très souvent dans le milieu. Votre création a une valeur, c’est votre bébé, il faut la porter à sa juste valeur. » Tatiana Botovelo, confirme cette image en ajoutant : « La durée moyenne d’un documentaire, depuis le début de l’écriture jusqu’au final cut, c’est de 5 à 6 ans, donc c’est un grand bébé. »

Canal+ Réunion/Mayotte, acteur toujours aussi stratégique ?#
Des projets à soutenir, Canal+ Réunion en est justement à la constante recherche. Samantha Nahama, directrice générale Canal+ Réunion/Mayotte, invitée à intervenir, est venue rappeler le rôle de cette plateforme audiovisuelle dans la diffusion de projets cinématographiques des deux îles des Mascareignes, pour leur faire passer les frontières et gagner la visibilité qu’ils méritent. Ce chemin de gloire, le film Zamal Paradise l’a emprunté. Ce film tourné, réalisé et produit à La Réunion, avec peu de budget par le rappeur DKpit, fait de « très bons chiffres d’audience » sur la plateforme française. Des chiffres qui resteront tout de même tus, justifiés par Samantha Nahama par le fait que Canal+ soit désormais entré en bourse.
À cela s’ajoutent des directives plus strictes de la part du groupe national envers le groupe Réunion/Mayotte, sur les droits de diffusion. Pour l’heure, les portes restent ouvertes aux talents réunionnais pour rejoindre la liste des programmes à succès soutenus, comme Cari Vip, mettant en lumière le caritologue André Béton, Verbatim , explorant la lourde thématique des violences sexistes et sexuelles au sein des entreprises sous format documentaire, ou encore Koungou, fruit du travail de deux réalisateurs mahorais : Naftal Dylan S. & Mass Youssoufa.
Plusieurs appels à projets sont lancés pour les prochains mois. À pourvoir : des financements pour réaliser une série de fiction sous forme « d’adaptation audacieuse, surprenante et inattendue de nos contes, mythes et légendes, croyances ou traditions », ou encore un film long de 90 minutes. À la clé, une diffusion sur la plateforme Canal+ Réunion/Mayotte, qui pourrait servir de tremplin pour le cinéma local.
Léa Morineau et Sarah Cortier